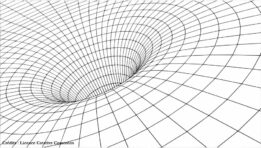Avec cet article, l’auteur propose une analyse rigoureusement étayée, s’inscrivant dans une vaste perspective historique. L’analyse expose les origines, les évolutions, les inflexions, les permanences du corpus de règles juridico-éthiques visant à encadrer l’activité guerrière en Islam. Au travers des statuts, des prérogatives, droits et devoirs des différents acteurs, chefs de guerre, combattants et non-combattants, se dégage une théorie juridique de la guerre en Islam, permettant en outre de mieux comprendre le djihadisme contemporain.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont: Anne de Luca, « Le calife, le soldat et le paysan : l’art de la guerre en islam », Les cahiers de l’Orient, Hiver 2017.
Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être visionnés sur le site des Cahiers de l’Orient.
Le calife, le soldat et le paysan : l’art de la guerre en islam
« Ne tuez aucun être qu’Allah a décrété comme étant sacré, à moins que cela ne se justifie en droit. » Coran, sourate XVII, verset 33[1]
Cette présentation de la guerre en islam s’inscrit dans une approche purement historique qui, certes, peut apporter des clés de compréhension du phénomène jihadiste contemporain, mais dont la finalité n’est pas d’analyser cette mouvance. Suivant cette perspective historique, ce travail vise à dégager une théorie juridique de la guerre spécifique à l’islam.
Des sources diverses
D’entrée de jeu, le chercheur se heurte à une première difficulté : l’approche juridique pure ne permet pas de rendre compte de la totalité des normes encadrant l’activité guerrière dans la civilisation islamique. D’autres sources non spécifiquement juridiques viennent composer ce qu’il serait plus juste de dénommer un art de la guerre. En effet, le combattant doit respecter les normes scripturaires, les pratiques tirées de la tradition du Prophète et les règles juridiques élaborées par les docteurs de la loi ; à cela s’ajoute également la dimension éthique. Celle-ci puise dans la pratique des califes rachidoûn ou « bien guidés » (les quatre premiers califes ayant succédé au prophète Muhammad) et des combats qu’ils menèrent lors de leurs conquêtes. Le référentiel du combattant musulman apparaît ainsi composite.
Toutes ces sources ont donné lieu à une littérature spécifique, visant à caractériser le comportement idéal du guerrier mais aussi à régir les relations de l’empire islamique avec les contrées voisines. Ainsi la doctrine juridique se développe t-elle au sein de traités que l’on appelle siyar. Les auteurs les plus célèbres de ce type d’ouvrages sont principalement des juristes du VIIIe siècle : al-Fazârî, al-Awzâî ou encore al-Shaybânî[2] apparaissent comme parmi les plus illustres. Cette littérature s’intéresse à l’attitude du chef de guerre exemplaire et traite par ailleurs d’une grande diversité de thèmes comme le commandement, la territorialité et la définition des frontières, les pactes, les règles de partage du butin, le commerce entre belligérants… Autre tradition littéraire, les Miroirs des princes, apparus dès la fin du VIIe siècle, se consacrent à la conduite du pouvoir politique pour une meilleure gouvernance. Ces écrits prennent pour référence l’expérience passée des anciens empires sassanide, byzantin et indien, afin de dégager les règles de la conquête et de la conservation du pouvoir. Situé à mi-chemin entre l’histoire, l’éthique et les belles-lettres, ce genre littéraire se caractérise par une recherche des meilleures pratiques, dépourvue de tout préjugé à l’égard du savoir hérité d’autres civilisations, quand bien même ces dernières seraient païennes. Les Miroirs se veulent une guidance, un ensemble de conseils donnés au souverain pour l’éclairer dans son comportement et ses décisions. L’éthique du combattant fait partie des thèmes abordés. Enfin, quelques ouvrages traitent de la guerre sous un angle plus technique : il s’agit des traités de stratégie militaire, comme La conduite de la guerre du général al-Arthamî sous le califat abbasside. Tous ces courants littéraires permettent d’identifier un ensemble de normes régissant l’art de la guerre islamique.
Une évolution progressive
Deuxième constat, ce cadre normatif est en réalité d’une grande plasticité et évolue au gré du temps, mais surtout des victoires ou des déroutes des armées. Les règles qui le composent ont ainsi une certaine relativité. L’élaboration du droit classique s’est faite dans un contexte d’apogée culturelle et de supériorité militaire du monde arabo-musulman. Un triomphe qui marquera d’ailleurs l’âge d’or de l’Islam comme civilisation et qui se rattache particulièrement au règne abbasside (750-1258). Dès la mort du Prophète, l’islam connaît en effet une expansion fulgurante qui dépassera rapidement les frontières de son berceau naturel, la péninsule Arabique. La formalisation du droit de la guerre se fait ainsi à partir du paradigme des conquêtes.
Enfin, la définition d’un art de la guerre islamique s’avère complexe à appréhender au point de vue sémantique : il existe en effet une pluralité de concepts renvoyant à l’activité guerrière dont certains ont eux-mêmes plusieurs acceptions. La diversité du champ lexical martial se retrouve dans le Coran : harb désigne la guerre, qital correspond au combat tandis que jihâd renvoie à l’activité militaire[3]. La formalisation du jihâd par les juristes constituera la théorie de la guerre juste.
En dépit de la plasticité des concepts, on peut toutefois convenir qu’il s’est formé dans le monde musulman un corpus de règles visant à encadrer l’activité guerrière. Pour l’appréhender, nous avons choisi d’aborder l’art de la guerre à travers ses acteurs : le calife, en sa qualité de chef de guerre (I), les combattants (II) mais aussi les non combattants qui malgré eux, se trouvent impliqués dans les affrontements (III).
I- Le calife, garant du dar al-islam
Pendant près de treize siècles (632-1924), le califat sera l’incarnation par excellence de l’État islamique. Si l’institution califale apparaît d’abord pour assurer la continuité du message coranique, elle assume également la gestion des affaires temporelles de la communauté musulmane. Les deux aspects du pouvoir sont présents dès l’origine. Parmi les responsabilités qui incombent au calife se trouve celle de propager l’islam et de défendre les croyants : son sacerdoce comporte ainsi une dimension guerrière évidente. À cet égard, il lui revient de décider de l’entrée en guerre (A), décision qui doit reposer sur de justes motifs (B).
A. Du successeur du Prophète au chef de guerre
On retrouve un certain nombre de similitudes entre la théorie de la guerre islamique et la guerre juste telle qu’elle a été formalisée en Occident[4]. Parmi les critères partagés par les deux traditions apparaît celui de l’autorité légitime. Celle-ci est incarnée en islam par la personne du calife : la formalisation du califat a cependant été un processus difficile, car l’institution n’est pas expressément prévue par le message coranique. Elle connaîtra de nombreuses évolutions, fruits de constructions intellectuelles destinées à renforcer le pouvoir du souverain (1). Nous évoquerons ensuite les prérogatives de ce dernier dans le domaine militaire (2).
1) La théorie du califat
Le Prophète Muhammad meurt en 632 sans laisser de consignes particulières quant à sa succession ; le texte coranique ne comporte pas non plus de prescription à ce sujet. Le choix de son successeur est à l’origine du plus grand schisme qu’a traversé l’islam. Dans un premier temps, le pouvoir revient assez naturellement aux compagnons du Prophète et l’on parle alors de l’ère des califes bien guidés (Rachîdoûn). Leur désignation résulte d’un mode quasi électif, inspiré d’une ancienne tradition tribale (la choura). Mais leur légitimité tient surtout à leur proximité avec Muhammad de son vivant. Le califat ouvre ainsi une nouvelle conception du pouvoir dans une Arabie qui ne connaissait que des structures tribales. C’est Omar, le deuxième calife, qui prendra officiellement ce titre[5]. Le calife règne d’abord pour assurer la sauvegarde de la religion. Il trouve sa justification dans le besoin d’assurer le maintien et l’application de la loi révélée. Dès lors, ses pouvoirs s’en trouvent par là-même limités : il est détenteur du pouvoir exécutif car la loi n’appartient qu’à Dieu et réside dans le Coran, immuable. Il a tous les pouvoirs de la puissance publique mais ne peut modifier la Loi révélée à laquelle il est assujetti comme tout musulman. Les affaires religieuses lui échappent ainsi et appartiennent aux oulémas[6]. À l’instar du Prophète, le calife occupe sa charge à vie.
L’institution califale n’ayant pas été prévue dès le vivant de Muhammad, elle n’est théorisée que progressivement. Cet effort de formalisation apparaît assez tardivement au Xe siècle et doit s’appréhender comme une réaction à la vision chiite du califat – pour ce courant, minoritaire en islam, c’est Ali, le gendre du Prophète, qui aurait dû lui succéder. Il fallait donc légitimer les trois premiers califes, contestés par les chiites et les kharidjites[7]. Ce travail de légitimation entrepris par les théologiens et les juristes aboutit à une théorie défendant très clairement une conception absolutiste du pouvoir.
S’inspirant des califes bien guidés, le juriste al-Mâwardî étudie cette institution dans Les Statuts gouvernementaux. Il y énumère sept qualités permettant de prétendre au califat, que l’on peut résumer ainsi : l’honorabilité ; la capacité de raisonnement ; la pleine capacité de l’ouïe, la vue, l’usage de sa langue ; la faculté de ses membres ; le jugement ; la bravoure et l’énergie requises pour défendre le territoire musulman et combattre l’ennemi ; l’appartenance au lignage Quraychite (tribu du Prophète). À ces conditions, les théologiens ajouteront le principe de masculinité, le statut d’homme libre et l’islamité.
Aucun des califes bien guidés n’est arrivé au pouvoir de la même façon, ce qui a posé quelques difficultés aux juristes pour formaliser les règles d’accession au califat[8]. En théorie, la doctrine sunnite consacre le principe électif : en pratique, les califes désigneront leur successeur de leur vivant. Progressivement, cela aboutira à une véritable monarchie héréditaire. Ainsi, la charge califale n’existera vraiment que sous les califes bien guidés ; avec les Omeyyades et les Abbassides s’ouvre l’ère du pouvoir dynastique. Pourtant, à aucun moment ces derniers ne se revendiqueront d’une légitimité héréditaire : ils continueront à entretenir la fiction du principe électif tribal dont la nomination du successeur ne serait qu’une variante.
La charge califale comporte une dimension contractuelle : elle repose en effet sur un pacte entre la communauté, qui prête allégeance (bay’a) au souverain, et ce dernier, qui s’engage à gouverner avec sagesse. La dimension contractuelle permet également de compenser un certain vide s’agissant du nombre d’électeurs devant participer à la proclamation. Le serment d’allégeance est prêté par les électeurs et les notables. Néanmoins, il ne fait pas le calife : ce cérémonial se veut purement déclaratoire et manifeste la soumission au pouvoir. L’approche théologique considère en effet que c’est bien de Dieu que le calife tient son autorité. On notera que la destitution d’un calife illégitime par la communauté est théoriquement prévue, mais les juristes auront tendance à estimer qu’un mauvais calife reste préférable à la guerre civile et au chaos.
En sa qualité de défenseur de la communauté musulmane, le souverain se voit attribuer des prérogatives militaires.
2) Les prérogatives militaires du calife
Si les modes d’accession au califat ont pu varier en fonction des circonstances, un aspect demeure intangible : il s’agit toujours d’un engagement solennel au service de la défense de l’islam et de la communauté. Et cela implique la défense armée. Le sabre fait partie de l’arsenal du calife pour remplir ses responsabilités de chef de la oumma[9], à savoir le maintien de la religion, la garantie de la justice, la protection du dar al-islam[10] et de ses habitants. D’ailleurs, le bon souverain est aussi celui qui possède la « vertu téméraire et guerrière »[11], selon le philosophe Alfarabi. Cette approche martiale du califat se renforce dans le courant du XIe siècle : les foyers de tension se multiplient alors dans le monde musulman et menacent son unité ; le calife apparaît dès lors comme le défenseur de la foi musulmane et du dar al-islam. Les siyar posent clairement le principe selon lequel la guerre est une activité qui se mène sous le commandement d’un prince : elle est subordonnée au politique.
Il revient au calife de décider du déclenchement des hostilités. Partant du principe que le but de l’affrontement n’est pas l’anéantissement de l’ennemi ou sa spoliation mais sa conversion, tout combat doit commencer par l’invitation à embrasser l’islam (la da’wa). Progressivement pourtant, les juristes vont reconsidérer cette exigence, notamment à la lumière de la nécessité militaire : avertir l’adversaire, c’est aussi lui donner l’opportunité de se préparer au combat ; or, dans la tradition juridique islamique, la ruse est une stratégie reconnue. Selon cette vision très opérationnelle, aucune sanction ne frappe le déclenchement des hostilités sans appel préalable à embrasser la religion de l’islam.
En sa qualité de chef de guerre, le calife est responsable du partage du butin ; il doit également connaître tout son armement et l’état de ses réserves de nourriture pour s’assurer de sa capacité à aller au combat. Au XIIe siècle, le Syrien al-Harawi écrit un traité à l’attention d’un sultan ayyoubide, dans lequel il énonce les qualités attendues du chef de guerre : « Que le chef soit un homme doué de jugement, de raison, d’astuce et de ruse, qui sache prendre conseil de ses compagnons et des chefs de sa troupe, se faire précéder d’éclaireurs, s’assurer des informations, choisir des gîtes d’étapes, commander ses hommes, organiser son détachement, se faire écouter quand il parle, obéir quand il ordonne, obtenir que tous marchent comme un seul corps et s’arrêtent comme un édifice bien construit (…). »[12] Bien qu’il décide de l’entrée en guerre contre l’ennemi, le calife ne peut recourir aux armes que sur de justes motifs, que la tradition juridique a parfois définis en prenant certaines libertés avec le message coranique.
B. Les motifs de la guerre juste
La légitimité des motifs permettant de déclencher les hostilités est progressivement théorisée et se fonde sur des principes qui évoluent en fonction des besoins de la communauté musulmane. Initialement, la guerre est envisagée selon une approche purement défensive pour finalement se mettre au service d’une logique impérialiste (1). Une fois l’Empire musulman constitué, il est très vite émaillé de luttes intestines qui poussent la tradition juridique à justifier l’attaque de sujets musulmans (2). Les conquêtes peuvent donner à penser que la guerre s’impose comme un état permanent, jusqu’à la soumission de la terre entière ; on trouve pourtant une position plus nuancée dans la littérature des Miroirs, qui estime qu’il ne faut déclencher les hostilités qu’en dernier recours, quand la ruse et la diplomatie n’ont pu l’emporter (3).
1) De la survie de la tribu à la suprématie de l’islam
À l’époque antéislamique, la guerre est liée à la survie du groupe, en ce sens qu’elle participe à la répartition des richesses dans un environnement hostile : dans le désert, les ressources sont limitées, créant une compétition entre les humains qui y vivent. La guerre s’apparente alors à un régulateur social, assurant un équilibre entre les tribus. L’arrivée du message coranique marque une rupture à cet égard, en conférant à la guerre une autre finalité : désormais, ce n’est pas l’accès aux ressources qui est en jeu mais bien la survie d’une idéologie. L’islam est arrivé dans un milieu polythéiste qui n’était pas prêt à céder du terrain à une religion remettant en question son système de valeurs : toute une économie reposait alors sur ces croyances antéislamiques, et La Mecque en bénéficiait largement. Dans ce contexte, la communauté musulmane a rapidement rencontré une forte hostilité, allant jusqu’à la volonté de décimer le groupe. Muhammad se heurte en effet à l’oligarchie qurayshite, dont la richesse dépend en grande partie des pèlerins polythéistes. Au début, le groupe tente d’opposer une résistance pacifique, mais les agressions répétées vont le contraindre à apporter une réponse armée pour sa survie.
Le Coran fait état de cette persécution, et il apparaît clairement que l’oppression et les injustices que subissent les nouveaux croyants constituent un casus belli. De même la rupture d’un pacte est-elle assimilée à une injustice de nature à fonder le recours aux armes. Le message coranique envisage ainsi le combat dans une dimension défensive : les guerres dont il fait mention sont destinées à mettre fin aux injustices perpétrées contre les musulmans. Le premier passage coranique autorisant le recours à la force armée dans ce cadre figure aux versets 39/40 de la sourate XXII : « Permission est donnée à ceux qui combattent à la suite d’une injustice (…), à ceux qui ont été injustement chassés de leurs maisons uniquement parce qu’ils avaient dit : “Notre Seigneur est Allah”. » De même, au verset 217 de la sourate II, il est affirmé que « (…) plus grave encore est le fait de se détourner de la voie d’Allah, de ne pas croire en Lui et à la Mosquée sacrée, ou encore de chasser ses occupants. » Le verset 190 de la même sourate pose clairement le principe de la violence défensive : « Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas des provocateurs, car Allah n’aime pas les transgresseurs. » Ce faisant, le message coranique pose les bases d’une nouvelle solidarité fondée non plus sur le groupe lignager mais sur l’appartenance religieuse ; solidarité qu’illustre d’ailleurs la Constitution de Médine[13]. La littérature des Miroirs des Princes s’inscrit dans cette approche défensive, elle-même en résonance avec la guerre juste telle que théorisée par Saint-Augustin : ces différents écrits véhiculent l’idée qu’il ne faut pas être l’agresseur et que seule l’hostilité de l’autre peut justifier de prendre les armes. Ainsi, les Miroirs ne reconnaissent au souverain le droit de faire la guerre qu’au regard de la défense de l’islam.
On notera cependant que le Coran alterne les passages entre clémence et intransigeance. Le rapport de l’islam à la violence évolue au cours de la prédication coranique[14]. Ainsi, à Médine, le message coranique adopte des accents plus belliqueux : Muhammad est alors le chef d’une communauté et il doit en assurer la survie au sein d’une Arabie dominée par le polythéisme. La logique tribale va l’obliger à mener un certain nombre d’affrontements. On trouvera ainsi des versets plus enclins à une logique offensive : « (…) combattez les idolâtres là où vous les trouverez. Prenez-les, assiégez-les et attendez-les en embuscade. »[15] De même dans la sourate II, verset 216 : « On vous a prescrit le combat, bien qu’il vous répugne (…). » Ou encore : « Combattez dans la voie d’Allah à la hauteur de ce qu’Il conçoit. »[16]. Aujourd’hui, ces textes constituent la référence et la caution des groupes islamistes radicaux dans leur promotion du terrorisme. Ils n’ont pourtant pas la valeur normative et intemporelle qu’on leur prête : ces passages n’ont leur raison d’être et ne prennent sens qu’au regard du contexte particulier où ils ont été révélés[17].
Bien avant l’islam radical contemporain, les juristes de l’époque classique vont utiliser ces références coraniques pour élargir les buts de guerre en même temps que se développe l’ère des conquêtes : la guerre se politise, passant d’une logique de survie à une logique d’expansion. On voit ainsi combien la conception de l’activité guerrière est indissociable de l’environnement géopolitique dans lequel elle s’insère. La théorie que définissent alors les juristes est à mettre en miroir de ce contexte marqué par l’irrésistible expansion de l’Islam[18], portée par des armées invincibles. En filigrane, cette littérature véhicule l’idée selon laquelle la guerre a servi et a permis la diffusion de l’islam. Suivant cette approche, les juristes établiront comme juste le combat contre ceux qui, après y avoir été invités, se refusent à embrasser l’islam ; combat qu’il conviendra de mener jusqu’à ce qu’ils se convertissent ou se placent sous la domination islamique en s’acquittant d’un impôt (dhimma). Le célèbre historien et philosophe Ibn Khaldûn estime ainsi que les musulmans ont le devoir de convertir le monde, de gré ou de force.
Les guerres de conquêtes trouvent donc leur fondement dans un choix politique que valident a posteriori les juristes et non dans le texte coranique. La politisation de la guerre apparaît aussi dans son emploi pour préserver l’institution califale.
2) L’unicité du califat
La doctrine juridique classique conçoit la théorie de la guerre selon une approche absolutiste visant à consolider le pouvoir central. L’unité du califat renvoie à sa vocation universelle qui ne souffre aucune concurrence. Tout au plus peut-il déléguer son pouvoir, mais il en reste la source unique et peut tout aussitôt le reprendre. Son autorité s’exerce non seulement sur les musulmans mais également sur les non musulmans qui sont sous sa protection.
L’unité est un élément structurant de l’identité islamique : un Dieu unique, un livre sacré, une seule communauté, une même orientation pour la prière… Le rassemblement de la communauté sous la bannière d’un chef unique participe de cette quête de l’unité. Le calife incarne en sa personne cet idéal d’unicité dont il est aussi le gardien[19]. Le penseur Ibn Khaldûn considère ainsi que la défense de la cause de Dieu mais également de la sauvegarde de la souveraineté califale constituent des motifs de guerre honorables. Ce besoin de préserver l’unité de la religion et de la communauté musulmane s’est imposé avec d’autant plus de force que l’imaginaire musulman reste profondément marqué par le schisme survenu entre sunnites et chiites. Aux origines même de l’islam, cette opposition, appelée fitna, a irrémédiablement coupé la oumma en deux. Un profond traumatisme qui conduit les juristes à valider le principe du recours aux armes pour préserver l’unité vaille que vaille. Il devient alors très facile de proclamer légitime toute guerre ayant pour objectif de mettre fin aux dissensions qui traversent la communauté musulmane. On perçoit bien ici que la théorie juridique se met au service d’une vision absolutiste du pouvoir et que toute forme de rébellion et d’opposition politique ouvre potentiellement la voie à la répression armée. Les juristes convoquent ainsi un passage coranique qui condamne toute forme de sédition :
« Si deux clans issus du rang des croyants se combattent, établissez la concorde entre eux. Si l’un des clans persévère dans sa provocation, combattez celui qui en est responsable jusqu’au moment où il s’en remet à l’ordre normal d’Allah. »[20]
L’unité de l’islam est aussi menacée par la rivalité née de la multiplication des centres de pouvoir. Le XIe siècle est ainsi celui de la dislocation de l’empire : le pouvoir des Abbassides est concurrencé par la sublime Al-Andalus, puis viendra la dynastie fatimide en Égypte. Dès le troisième siècle de l’hégire, le pouvoir califal passe aux mains des sultans. Enfin, au XVIe siècle, l’arrivée de la dynastie ottomane marquera l’avènement au pouvoir d’une lignée ne descendant pas d’une famille du Prophète. Finalement, l’unité du califat n’aura été une réalité que sous les quatre premiers califes, bien que sous Othman déjà, l’insubordination menaçait.
3) Le dernier recours
Quand bien même les justifications seraient réunies, la guerre n’apparaît pas souhaitable, du moins dans la tradition des Miroirs des princes : celle-ci décrit la guerre comme une maladie en insistant sur le fait que la politique lui est préférable. Pour autant, la diplomatie n’interdit pas de recourir à des ruses et stratagèmes : tout ce qui concourt à l’atteinte des buts politiques sans l’usage de la violence est un bien. Cette approche repose notamment sur le recueil de Kalila wa Dimna, dont la fable « Les hiboux et les corbeaux », en illustre le principe. L’économie de vies humaines doit toujours être recherchée. Auteur andalou du XIe siècle, al-Murâdî considère ainsi qu’il faut éviter au peuple la souffrance d’une guerre : « Le plus habile des peuples est celui qui ne recherche pas le pouvoir au moyen du combat de ce qui est différent de lui. Car la guerre (harb) fait perdre des existences et dépenser des fortunes. Les Sages disaient : l’ennemi est semblable à un abcès que l’on soigne d’abord par l’apaisement, l’examen et le soulagement. (…) La guerre est le remède ultime qu’il faut employer… (…) Sache que toute personne sensée, même assurée de sa force, de son invincibilité, de sa suprématie, ne s’expose pas nécessairement à nuire, par l’agression et l’hostilité, à sa bonne fortune bâtie sur sa confiance et sa croyance en la force dont il dispose. »[21]
Fort de ce principe, il articule sa stratégie globale en trois étapes : – maintenir des relations cordiales pour favoriser la voie du dialogue ; – recourir à la ruse, aux pièges et aux stratagèmes si l’adversaire persiste dans son attitude belliqueuse ; – enfin, consentir à la guerre lorsque toutes les possibilités pacifiques sont épuisées. Cela suppose que le souverain soit maître de ses passions et qu’il sache gouverner avec tempérance. C’est donc davantage ses qualités de diplomate qui sont saluées par la tradition des Miroirs qu’une image de féroce guerrier. Tout l’art de la guerre consiste à l’éviter.
La guerre doit donc demeurer un état d’exception par rapport à la paix et à la sécurité. Toutefois, les Miroirs se veulent réalistes et partent du principe que la nature humaine est belliqueuse et qu’elle rend la conflictualité latente. Il convient alors de s’y préparer en permanence, notamment pour conserver le pouvoir. Les traités militaires exhortent le chef à la prudence et à la méfiance. La ruse ne doit pas dispenser le prince de se préparer à la véritable guerre : il lui faut envisager la possibilité que la radicalisation du conflit devienne inévitable. La tradition juridique, en revanche, est bien moins explicite sur le sujet et semble avoir un rapport beaucoup plus décomplexé au recours à la force. Dans cette conception, la guerre juste est tout autant défensive qu’offensive : « les premières théories du jihâd sont représentatives d’un islam ivre de sa puissance politique et de sa vitalité culturelle. »[22] Fondé durant l’ère glorieuse des conquêtes, le cadre juridique du jihâd comporte une dimension belligène assumée. De même, les chances de succès ne constituent pas un thème donnant lieu à des développements détaillés. Seuls les hanéfites[23] dissuadent de recourir à la guerre si les maux semblent plus grands que les gains.
Enfin, la violence armée ne doit pas être une fin en soi : elle ne se justifie qu’autant que durent l’injustice et les persécutions. Entretenir la guerre pour la guerre est le vice suprême d’après le philosophe Alfarabi[24]. Il est ainsi souvent fait référence à la trêve d’al-Hudaybiya conclue en 628 entre Muhammad et les Qurayshites, montrant que le combat doit cesser dès lors que l’objectif est atteint : ici, le ralliement à l’islam.
II. Combattants et non combattants
Tout comme en Occident, la tradition juridique islamique dissocie les combattants (A) des non combattants (B). Les critères permettant de définir ces deux catégories sont diversement appréciés au sein des différentes écoles juridiques. La raison tient notamment au fait que cette classification repose sur le facteur confessionnel : selon qu’ils sont musulmans, gens du Livre[25] ou polythéistes, les acteurs connaîtront un sort variable. De même, le comportement dans la guerre et les limites posées à la violence montrent souvent de profondes différences d’approche.
A. Les combattants
Au rang des combattants figurent d’un côté les soldats musulmans (1), de l’autre les forces adverses (2) ; or, la typologie de l’ennemi s’avère complexe à dresser car fluctuante, à travers le temps et en fonction des intérêts en présence[26]. Elle obéit bien plus à des considérations politiques que purement religieuses.
1) Le mujâhid : le combattant musulman
Dans la cité islamique, la défense du dar al-islam est un devoir collectif qui devient individuel en cas d’attaque surprise de l’ennemi et de mobilisation générale. Ignorer l’appel du jihâd, c’est s’exposer au risque de ne pas recevoir les derniers sacrements. Pour devenir un combattant du jihâd, un mujâhid, il convient de réunir un certain nombre de conditions, la première étant d’être musulman. Il faut également être majeur, pleinement responsable de ses actes et libre d’agir. L’impubère peut prendre part au combat s’il a obtenu l’autorisation de ses parents. Le candidat doit également être de sexe masculin, de condition libre, sain de corps et d’esprit ; il doit avoir des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et de s’équiper, ce qui implique de ne pas avoir de dettes.
La masculinité du guerrier ne soulève aucune contestation et les juristes sont unanimes sur ce point : une femme ne saurait prendre part au combat. Les raisons avancées sont multiples, voire, pour certaines, cocasses : on citera ainsi l’argument selon lequel leur présence pourrait exciter la fougue de l’adversaire[27]. Il est toutefois admis qu’elles puissent se rendre utiles pour panser les blessés ou tenir lieu de cantinières. Dans certains cas, les épouses peuvent accompagner le combattant mais ne peuvent pour autant prétendre au statut de mujâhid.
L’islamité du combattant, en revanche, a pu susciter des débats : chez les hanafites, on autorise les gens du Livre à combattre, dans la mesure où le commandement reste aux mains des musulmans[28]. D’autres juristes voient au contraire dans cet interdit une façon de réserver le prestige du guerrier aux musulmans et de rappeler aux protégés leur infériorité sociale. Le mujâhid incarne en effet un personnage jouissant d’une forte considération dans la société médiévale. Et comme tel, il doit adopter un comportement exemplaire. Cela commence par le respect de l’autorité du chef, l’émir, derrière lequel tout combattant se range. La mutinerie et la désertion sont de ce fait condamnables. Plus largement, la discipline constitue un aspect essentiel de la vie du combattant ; les actes de délinquance peuvent ainsi donner lieu à des châtiments : il est cependant préférable de les infliger une fois de retour sur le territoire musulman, dans le but de préserver les capacités de combat. La discipline doit également se manifester dans le respect des règles de partage du butin de guerre[29] : un arbitre est spécialement chargé de départager les revendications et de régler les différends lors de la répartition.
Le combattant doit par ailleurs réunir des qualités morales, telles que la patience. Il doit aussi agir selon une intention sincère et désintéressée, animé par la seule volonté de défendre la religion. Le butin ne doit donc pas être le moteur de son engagement. Le Coran fait ainsi le récit de plusieurs batailles perdues parce que les soldats étaient principalement animés par la recherche du gain[30] : c’est notamment le cas de la célèbre défaite d’Uhud[31]. Plus largement, les qualités morales impliquent de se conformer au message coranique. Al Mâwardî écrit ainsi dans ses Statuts gouvernementaux : « Celui qui fait la guerre sainte est plus que tout autre lié par les prescriptions divines et astreint à distinguer le licite de l’illicite. »[32] Toutefois, il est admis que le mujâhid n’est redevable que de trois prières quotidiennes en campagne. Il peut aussi être dispensé de jeûner si la guerre se déroule durant le mois sacré de ramadân. Au plan de l’usage de la violence, le comportement exemplaire du combattant impose le respect d’un code de l’honneur qui lui interdit certaines pratiques, tant à l’encontre des combattants que des non combattants : la mutilation est ainsi proscrite[33]. Il peut en revanche avoir recours à la ruse et pratiquer l’espionnage pour connaître le dispositif ennemi[34]. La question du suicide est également clairement tranchée par les différents traités juridiques et la règle de son évitement est incontestablement posée[35].
Enfin, l’exemplarité du mujâhid doit évidemment s’exprimer dans ses qualités guerrières et son mérite au combat. À cet égard, toutes les expéditions ne se valent pas. Ainsi, le milieu maritime étant réputé plus difficile, les campagnes navales sont davantage valorisées que les campagnes terrestres.
Si la définition du combattant musulman semble relativement consensuelle, celle de la figure de l’ennemi est plus difficile à appréhender.
2) L’ennemi
La détermination, ou plutôt la prédétermination de l’ennemi montre de profondes différences entre son appréhension par le Coran, par les Miroirs des princes et sa désignation par les juristes. Comme pour les motifs de guerre juste, l’ennemi demeure conjoncturel.
Le critère religieux, auquel on songe en premier lieu, illustre parfaitement les divergences entre les différentes sources normatives. Le Coran ne commande pas de faire la guerre aux autres peuples au nom de leurs croyances[36]. La diversité des religions apparaît d’ailleurs comme le résultat de la volonté divine : « Car, si Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. »[37] Aucun passage ne lie la propagation du message coranique à la guerre. En d’autres termes, la conversion n’est pas un motif de guerre légitime dans le texte révélé, qui ne fait pas l’apologie de la conversion par la force. Au contraire, il invite davantage à susciter l’adhésion par la discussion : « Appelle-les au bon chemin de ton Seigneur en usant de sagesse et d’exhortation généreuse. »[38] De même, d’autres passages encouragent le croyant à entretenir de bonnes relations avec les peuples de confessions différentes, y compris les polythéistes : « Dieu ne vous dissuade pas d’être bienveillants et équitables avec ceux qui n’ont pas combattu votre religion et qui ne vous ont pas délogés de vos maisons. Allah aime les gens équitables. »[39] Enfin, le Coran affirme sans ambages la nature sacrée de l’être humain, quelle que soit sa religion : « Ne tuez aucun être qu’Allah a décrété comme étant sacré, à moins que cela ne se justifie en droit. »[40] Il existe pourtant certains passages postérieurs d’une résonance violente et ne montrant aucune tolérance pour les autres religions du Livre, comme le célèbre verset du Sabre[41]. Hormis ces épisodes, qu’il convient encore une fois de ne pas dissocier d’un contexte particulier, la philosophie de l’islam demeure le respect de la vie humaine et la propagation de la paix. Le théologien Ibn Taymîyya estimera ainsi que la mécréance n’est pas un motif suffisant de mise à mort : « Nous devons combattre uniquement ceux qui nous combattent (…).»[42] Et si le combat doit être mené, la paix peut toujours être conclue si l’ennemi la demande et reconnaît la suprématie de l’islam[43]. La finalité de la guerre n’est donc pas la conversion forcée, mais plutôt la consolidation de la position de l’islam comme religion dominante.
Ce sont les docteurs de la loi qui vont introduire le lien entre conversion et usage de la force, consacrant la guerre comme un moyen de propager le message coranique, de mener la da’wa[44]. D’activité profane, la guerre devient sous la plume des fuqahâ[45] un devoir religieux. Cette approche a deux conséquences : elle prédésigne, d’une part, l’ennemi sur une base confessionnelle et elle conditionne, d’autre part, la nature des relations que l’État islamique entretient avec ses voisins. La territorialité de l’ennemi conduit ainsi les juristes, notamment al-Shaybânî, à concevoir le monde de la façon suivante : – Le dar al-islam (territoire de l’islam) est l’espace où s’applique la loi islamique et qui est soumis au pouvoir d’un souverain musulman. Les musulmans y vivent en sécurité et pratiquent librement leur religion ; – le dar al-harb (territoire de guerre ou d’impiété) n’est pas soumis aux principes de l’islam et le musulman ne peut pas y pratiquer sa religion en toute quiétude. Il impose un état de guerre permanent ne pouvant s’achever que par la soumission à l’islam.
Plus tard, al-Mawârdî introduira une nuance avec ce troisième type d’espace, le dar al-Suhl (territoire de pacte), qui est gouverné par des non musulmans mais avec lesquels les relations sont normalisées par des traités et des accords. Or, le Coran enjoint les croyants au respect des pactes et engagements passés[46].
La religion n’est cependant pas le seul critère retenu par les juristes pour caractériser l’ennemi. La tradition juridique (siyar) établit ainsi une typologie distinguant, d’une part, les ennemis extérieurs et, d’autre part, les ennemis intérieurs. La première catégorie correspond aux polythéistes et aux gens du Livre : les polythéistes n’ont d’autre alternative que la conversion pour éviter la guerre. Les gens du Livre sont invités à embrasser l’islam ; ils peuvent cependant rester dans leur religion et pratiquer leur culte s’ils s’acquittent d’un impôt de capitation leur garantissant la protection du souverain musulman (dhîmma). Dans ce cas, ils sont considérés comme faisant partie du dar al-islam.
La catégorie des ennemis intérieurs apparaît quant à elle au XIe siècle, sous la plume d’al-Mâwardî, dans son traité Les Statuts gouvernementaux. Il s’agit ici de l’approche dite non classique du jihâd, visant un ennemi de confession musulmane. L’histoire tumultueuse des débuts de l’islam a donné de multiples occasions aux musulmans de s’affronter entre eux. Les juristes vont ainsi élargir la théorie du jihâd à ce cas de figure très particulier, étroitement lié à l’histoire des premiers temps qui suivirent la révélation. Il s’agit d’abord de lutter contre le pluralisme doctrinal et de préserver l’unité de la communauté. Or, celle-ci est étroitement liée à l’unité du califat, conduisant les juristes à rechercher toutes les voies permettant au souverain de se protéger des intrigues et des rivalités. Le concept d’ennemi intérieur offre aux docteurs sunnites le moyen de légitimer la lutte contre les dissidents politiques. Ils assimilent la rébellion à un acte d’injustice auquel il convient de mettre fin par la voie des armes. Dès lors, toute lutte menée sous la bannière d’un souverain musulman pour combattre ceux qui projettent de renverser le détenteur du pouvoir, relève de cette logique. Les divergences politiques seront ainsi très opportunément assimilées à des hérésies et combattues sous le blanc-seing du jihâd.
C’est suivant cette approche que les apostats ont été assimilés à des ennemis intérieurs. Sous la plume des juristes, ce terme désigne ceux qui se révoltent contre les successeurs du Prophète et qui refusent de payer l’impôt. Ce sont bien des coreligionnaires musulmans, mais qui se marginalisent en revendiquant un retour aux anciennes formes du pouvoir, à savoir le système tribal. Ils refusent ainsi de prêter allégeance au pouvoir central incarné par le califat et rejettent le principe de territorialité. Dans la tradition hanéfite, il est bien établi que faire la guerre aux apostats ne repose pas sur des considérations religieuses (un châtiment divin les attend) mais répond à une nécessité politique car ils peuvent causer du tort aux musulmans. L’apostat est perçu comme un facteur de désordre dans la société, nuisible à l’intérêt des musulmans. Le terme de kâfir, habituellement utilisé pour désigner les gens du Livre et les polythéistes, sera ainsi élargi aux musulmans refusant le système politique califal[47]. Le juriste alGhazâlî éditera une fatwa à la fin XIe siècle pour autoriser les Almoravides du Maroc à intervenir en Andalousie contre les taifas[48] afin d’empêcher l’émiettement du pouvoir. Ce document, émis par un des plus grands juristes de l’époque, autorise sans ambiguïté l’usage de la force armée contre d’autres musulmans.
Le jihâd contre l’ennemi intérieur constituera enfin un moyen d’assurer la suprématie du courant sunnite dans un monde musulman en proie aux divisions idéologiques. Ce concept sera ainsi dirigé contre les chiites. Ainsi, al-Ghazâlî exhorte le croyant à mener une lutte acharnée contre cette communauté, alors même qu’il était contemporain des croisades. Dans la tradition des Miroirs, en revanche, on ne prédésigne pas l’ennemi, sauf dans les textes relatifs aux croisades. La plupart du temps, l’adversaire est envisagé de manière générale. Les Miroirs pensent l’activité guerrière dans sa dimension stratégique et comme un instrument du politique.
Au-delà des protagonistes que sont les combattants, la guerre implique aussi la population civile, de même que tous ceux mis hors d’état de combattre, soit parce qu’ils sont blessés, soit parce qu’ils sont faits prisonniers.
B. Les non combattants
Outre les modalités permettant de déclencher les hostilités, les procédés guerriers apparaissent également encadrés. La codification des pratiques guerrières puise aux sources coraniques et dans la pratique du Prophète et de ses premiers compagnons. Ces normes convergent toutes vers un usage maîtrisé de la force : on trouve ainsi un certain nombre de principes invitant le combattant à épargner les populations civiles (1) tandis que les blessés et les prisonniers se voient protégés (2). En filigrane des limites imposées à la violence se trouve l’idée d’un retour à la paix et à l’équilibre qu’il convient de préparer et surtout de permettre en ne cédant jamais à une logique d’anéantissement.
1) La population civile
La tradition juridique opère une discrimination entre les combattants et la population civile, à laquelle il est interdit de s’attaquer : vieillards, femmes, enfants, malades, bénéficient ainsi d’une protection particulière. De même, la plupart des juristes enjoignent les combattants musulmans à épargner les moines, les artisans et les commerçants. Ibn Taymîyya élargit cette protection aux paysans lorsqu’ils travaillent dans les champs. Chez les hanéfites, c’est le fait de participer à l’effort de guerre qui assimile au statut de soldat : l’appartenance à une autre confession ne confère donc pas à elle seule le statut de combattant et ne saurait justifier la mise à mort. Les juristes s’accordent globalement pour épargner la population des affres de la guerre.
Cette limitation de la violence puise dans le texte coranique et dans la sunna, tradition du Prophète. Ainsi, le Coran condamne les actes de cruauté : « Que la haine éprouvée pour un peuple ne vous porte pas à être injustes à son égard. Soyez justes, car c’est là une posture très proche de la piété. »[49] On retrouve la même retenue dans les propos du Prophète, lorsqu’il s’adresse aux hommes partant au combat : « Ne soyez pas pusillanimes au moment de l’affrontement ; n’infligez pas de châtiment exemplaire au moment du triomphe ; ne soyez pas prodigues ; ne tuez ni vieillards, ni femmes, ni jeune enfant… »[50] Enfin, les récits relatant les faits d’armes des proches compagnons du Prophète font état de cet usage maîtrisé de la violence. C’est notamment ce qui ressort des recommandations que le calife Abu Bakr al-Siddiq adressera à ses hommes peu avant la conquête du Levant : « Lorsque vous vous trouverez face à l’ennemi, comportez-vous en bons musulmans (…). Si Allah vous accorde la victoire, n’abusez pas de vos avantages, prenez garde à ne pas tacher vos épées du sang d’un paysan et ne touchez ni les enfants, ni les femmes, ni les infirmes – même s’ils sont des hommes – que vous rencontrerez parmi vos ennemis. »[51]
La violence à l’encontre des populations civiles est par principe exclue mais elle peut aussi être expressément interdite par un pacte. Or, le Coran insiste fortement sur la parole donnée et le respect des accords : « Respectez les serments que vous prêtez en usant du nom d’Allah. Ne vous déjugez pas dès lors que vous avez établi un pacte quelconque, surtout si vous avez pris Allah pour garant. »[52] Suivant cette logique, les combattants musulmans ne peuvent pas s’en prendre aux bénéficiaires d’un pacte de protection permanente : tel est le cas des gens du Livre (dhimmîs) qui bénéficient d’une protection spéciale (dhimmâ), moyen d’assurer la paix civile tout en manifestant la supériorité de l’islam. La tradition malékite admet que puisse s’appliquer aux polythéistes arabes la jizya, un impôt spécifique venant sanctionner tout autant la soumission que le droit à la protection. Elle laisse la possibilité aux croyants de pratiquer leur culte sans être persécutés. Cette taxe tombe dès lors qu’il y a conversion à l’islam.
De même, il existe une protection provisoire qui consiste en un sauf-conduit (amân) concédé à un infidèle et qui garantit sa sécurité au sein du dar al-islam. Il peut ainsi circuler et commercer librement en territoire musulman. Cette couverture temporaire diffère de la protection permanente offerte aux gens du Livre, qui vaut tant pour la vie que les biens du bénéficiaire. Conformément aux données scripturaires qui enjoignent le croyant à respecter la parole donnée, le détenteur d’un sauf-conduit ne peut être attaqué. La protection peut cependant disparaître dès lors que le bénéficiaire commet un acte de malveillance à l’encontre des musulmans : c’est le cas s’il se livre par exemple à de l’espionnage. Le coupable est alors passible de la peine capitale.
La protection des populations civiles se conçoit selon une approche globale consistant à préserver des conséquences du conflit les moyens et infrastructures assurant leur survie. Des normes viennent ainsi encadrer les déprédations commises en territoire ennemi. La stratégie de la terre brûlée donne cependant lieu à des appréciations divergentes, et ce dès le premier siècle de l’islam. Les Omeyyades estimaient qu’il ne fallait pas infliger de dégâts inutiles dans les régions occupées, en s’attaquant aux arbres fruitiers, aux animaux domestiques, aux habitations… Abû Hanifa considère quant à lui que l’interdit ne vaut qu’une fois la victoire acquise : durant la guerre, tous les coups sont permis si cela peut profiter à la communauté musulmane. Cette position a fini par l’emporter chez la plupart des juristes sunnites : dès lors qu’il y a un intérêt stratégique, le soldat musulman peut recourir à certaines déprédations comme incendier des habitations, déclencher des inondations ou assécher les points d’eau… Tout ce qui peut concourir à accroître les chances de réussite et à affaiblir l’ennemi est jugé acceptable.
La protection des civils vaut également à l’égard des populations musulmanes, qu’il faut chercher à épargner des dangers de la guerre. Cependant, si l’ennemi utilise des musulmans, adultes ou enfants, pour tenir lieu de boucliers humains, les juristes estiment que les combattants peuvent lancer des projectiles, en s’efforçant autant que possible d’éviter leurs coreligionnaires[53]. Si toutefois l’un d’entre eux était atteint, les docteurs considèrent qu’il n’y a pas péché et que le prix du sang n’aura pas être versé par l’auteur.
Si la pratique générale incite plutôt à la protection des populations civiles, particulièrement pour celles bénéficiant d’un pacte, quelle place est-elle réservée aux stratagèmes dans l’art de la guerre islamique ? Dans la littérature des Miroirs, la ruse est considérée comme un moyen permettant d’éviter les tragédies d’un affrontement armé. On tolère des pratiques déloyales pour contenir l’escalade de la violence. Il s’agit cependant d’une vision plus pragmatique qu’empreinte de moralité. Le but final recherché est bien de parvenir à soumettre l’adversaire tout en préservant les capacités de combat. Suivant cette logique, la violation d’un sauf-conduit ou d’un pacte de protection peut être légitimée si elle permet effectivement d’éviter le basculement dans une guerre. Dans la littérature juridique ou théologique, la légitimité de la ruse est davantage critiquée : la parole donnée impose de se comporter avec loyauté pour la plupart des auteurs.
2) Les prisonniers et les blessés
« Traitez les prisonniers et ceux qui se rendent à votre merci avec pitié, comme Allah le ferait avec vous ; mais écrasez les fiers et les rebelles », aurait dit le calife Abu Bakr al-Siddiq[54]. En droit classique, les prisonniers sont juridiquement considérés comme des dépouilles de guerre. Leur sort diffère selon qu’il s’agit de combattants, de femmes ou d’enfants. Leur situation dépend également du stade du conflit et évolue si l’on se trouve pendant ou après l’affrontement. Pendant le combat, le Coran autorise de faire des captifs : « (…) Enchaînez-les pour les empêcher de fuir. »[55] En principe, seuls peuvent être faits prisonniers les combattants prenant une part directe au conflit, ce qui exclut les femmes, enfants, vieillards, infirmes. Survivance des razzias antéislamiques, la pratique sera pourtant courante de faire des captifs parmi les non combattants et de les réduire en esclavage. Beaucoup y verront aussi une opportunité d’acquérir de nouveaux esclaves et de s’enrichir sous couvert de mener le jihad[56].
Après les hostilités, le sort des captifs peut être réglé de deux façons selon le texte coranique : la rançon ou l’échange, et enfin l’indulgence par la restitution de leur liberté[57]. Force est de constater que sur ce sujet également, l’unanimité ne se fait pas au sein des juristes[58]. D’aucuns estiment que les prisonniers de guerre sont aux mains du prince, qui peut les tuer, accepter une rançon ou les réduire en esclavage. C’est au souverain de choisir la solution la plus appropriée, la plus conforme à l’esprit du droit et à l’intérêt général des musulmans. Plus intransigeant, Abû Hanîfa estime que l’échange ou la libération du combattant prisonnier n’est pas envisageable car elle correspondrait à une vente d’armes à l’ennemi[59]. Les femmes et les enfants sont en principe considérés comme prises de guerre et sont répartis entre les combattants pour être réduits en esclavage. Il était en outre interdit de séparer l’enfant de moins de sept ans de sa mère.
Conclusion : la politisation du jihâd
S’il est possible de brosser à grands traits les contours d’une tradition guerrière, la réglementation de cette activité est avant tout le fruit d’une représentation du monde elle-même construite sur le rapport de puissance qu’entretient l’islam avec ses voisins. En situation de toute puissance, le jihâd se veut offensif tandis que l’effritement du pouvoir au XIe siècle apporte une conception plus introvertie : on lutte d’abord contre les musulmans dévoyés. L’art de la guerre se structure ainsi autour de deux évènements que sont la construction de l’Empire islamique et la fitna (le grand schisme). Cela explique notamment l’instrumentalisation que les juristes de l’époque classique font du jihâd en l’assimilant à un vecteur de propagation de l’islam. De ce fait, la théorie juridique classique de la guerre apparaît essentiellement comme un travail de légitimation a posteriori des combats menés pour l’expansion de l’islam. Cette politisation du jihâd, qui se nourrit de l’ambigüité de certains passages coraniques, rend peu lisible le cadre normatif de la guerre en islam. Évoluant au gré des circonstances et des intérêts en jeu, il apparaît ambivalent et cristallise aujourd’hui les difficultés auxquelles l’islam contemporain est confronté avec le terrorisme jihadiste.
References
Par : Anne DE LUCA
Source : Les Cahiers de l'Orient
Mots-clefs : califat, calife, combattants, coran, guerre islamique, guerre juste, Islam, jihad, paysan, soldat