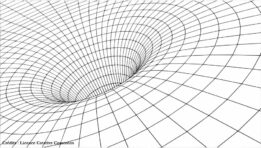Cet article s’interroge sur l’évolution du rôle du droit vis-à-vis des actions militaires. Le droit, de cadre normatif, devient-il également l’instrument d’une évolution de l’art de faire la guerre, à la croisée entre préoccupations d’ordre moral, politique et opérationnelle ? L’auteure nous présente avec rigueur et clarté un état des lieux documenté, argumenté, et souligne toute l’importance de cette problématique pour le débat stratégique.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont: Amélie Férey, «Droit de la guerre ou guerre du droit ? Réflexion française sur le lawfare», Revue Défense Nationale n° 806 – janvier 2018.
Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être visionnés sur le site de Revue Défense Nationale.
Droit de la guerre ou guerre du droit ? Réflexion française sur le lawfare
Qu’est-ce que le lawfare ?
Les recherches entreprises aujourd’hui sous l’égide du lawfare sont consacrées à l’étude des conséquences stratégiques de la judiciarisation croissante des interventions armées des démocraties occidentales[1]. Inventé par le général de l’armée de l’air américaine Charles Dunlap en 2001, ce terme de langue anglaise est forgé à partir de la contraction des mots « law », droit et « warfare », art de faire la guerre. Commentant les réactions inquiètes du commandement américain lors de l’intervention de l’Otan dans la guerre des Balkans de 1999, ce dernier parle « d’utilisation du droit comme une arme de guerre » et de la « stratégie d’utiliser – ou de mal utiliser – le droit comme un substitut à des moyens militaires traditionnels pour réaliser un objectif opérationnel. »[2] Il fait écho à des critiques s’interrogeant sur la possibilité que « le droit rend(e) la guerre injuste » puisqu’il ferait peser sur les armées occidentales des contraintes juridiques désavantageuses par rapport à un ennemi qui n’aurait cure du droit international[3].
Plus de dix ans après ce premier constat, la multiplication de publications dans des maisons d’édition renommées et des journaux à comité de lecture ainsi que la prolifération de blogs réunissant d’éminents spécialistes dédiés à cette question témoignent du dynamisme de ce champ de recherche[4]. Cette contribution se propose de nourrir le débat français sur le lawfare en dressant un premier état des lieux. Les analyses développées peuvent être d’autant plus pertinentes dans le contexte hexagonal que l’actualité française ravive cette question : le jugement de quatre militaires français en 2005 pour le meurtre du coupeur de route ivoirien Firmin Mahé[5] ; le procès pour viol de quatorze militaires français participant à l’opération Sangaris en Centrafrique en 2017[6] ou encore les récentes accusation de génocide lancés par l’article de la Revue XXI en juin 2017[7] sont autant de débats auxquels la grille de lecture du lawfare peut apporter une profondeur d’analyse.
Des définitions contradictoires
Une première difficulté sémantique complique la discussion sur le lawfare. L’abondance de la littérature s’accompagne d’une confusion dans le cadre conceptuel visant à saisir ce phénomène. Il désigne simultanément :
• L’utilisation du droit par des acteurs non étatiques afin d’accentuer l’asymétrie de la guerre. L’objectif est alors d’inciter la partie la plus forte à commettre des crimes de guerre dans le but de délégitimer son intervention. La pratique dite des « boucliers humains » visant à cacher des armes ou à placer des combattants recherchés dans le cadre des campagnes d’éliminations ciblées parmi les populations civiles afin d’empêcher toute action aérienne participe de ce type de lawfare. La volonté de l’organisation État islamique de retenir les habitants de la vieille ville de Mossoul à proximité des combattants afin de dissuader les forces de la coalition de bombarder le site est une illustration d’une utilisation possible du droit à des fins stratégiques.
• Une seconde acception du terme de lawfare désigne l’utilisation par les armées étatiques du droit afin de combler des vulnérabilités juridiques et de répondre à l’intérieur de la sphère légale aux stratégies déployées par l’ennemi. L’armée israélienne fait figure de pionnière dans ce contexte. Pour faire face aux recours à des « boucliers humains » décrits plus haut, Tsahal a développé une méthode dite de « frapper sur le toit » (« knocking on the roof »). Il s’agit d’envoyer une première charge explosive d’intensité réduite sur l’objectif à détruire afin de prévenir les habitants du bombardement imminent. Lors de l’utilisation de cette tactique à Gaza, les occupants disposent de cinq minutes pour évacuer leur appartement. Passé ce délai, le bombardement a lieu et leur statut juridique, selon l’interprétation de l’armée israélienne, change : ils deviennent des civils participants aux hostilités et peuvent donc être légalement ciblés[8]. L’armée américaine a récemment utilisé ces pratiques dans le cadre de l’opération Inherent Resolve dirigée contre l’organisation État islamique[9].
Le lawfare accompagne une mutation de l’art de guerre
La recherche sur le lawfare s’inscrit dans une réflexion de long terme sur le renouvellement de l’art de la guerre au XXIe siècle, visible dans l’environnement stratégique et dans la doctrine d’emploi des forces armées. Nous identifions des mutations de trois ordres :
• Les démocraties d’inspiration libérale évoluent vers un légalisme affirmé qui affecte leur ordre normatif. Ce phénomène a été décrit avec brio dès 1964 par la professeure de droit à Harvard Judith Shklar[10]. Elle montre comment des débats soulevant des enjeux politiques et moraux sont repris et formulés en termes légaux[11]. Dans des sociétés pluralistes et conflictuelles, le droit fournit un langage supposément neutre et consensuel utile pour régler les différends. Les tribunaux ont tendance à jouer le rôle d’arbitres entre des acteurs aux intérêts contradictoires. La confusion entre légalité et légitimité se renforce. Cette importance donnée au droit se double d’un recours actif aux tribunaux afin de contrôler plus étroitement la branche exécutive.
• Le lawfare s’inscrit également dans une nécessité politique de justifier les interventions militaires auprès de l’opinion publique nationale et internationale. Dans un double contexte de réduction budgétaire et de médiatisation accrue des conflits, la demande de justification des interventions armées dans les démocraties est forte. La transparence s’inscrit désormais au cœur de la légitimité de l’action publique. Cela soulève la question de l’adaptation de l’armée à ce nouvel impératif.
• Le lawfare accompagne enfin la mutation technologique liée à la révolution dans les affaires militaires[12]. La présence accrue de la technologie dans les forces armées garantit une supériorité stratégique mais pose un problème normatif interrogeant la responsabilité légale individuelle. Leur emploi conduit à repenser leur adaptation aux traités et au cadre légal existant – la question se pose particulièrement pour la régulation juridique du cyber ainsi que pour l’introduction de systèmes autonomes. Certaines de ces technologies permettent d’enregistrer, voire de suivre en temps réel la progression des forces. Les décisions prises sur le terrain sont supposément mieux informées, puisqu’elles prennent en compte davantage de paramètres. La responsabilité individuelle n’en est que plus lourde, d’autant que ces enregistrements peuvent constituer des preuves dans le cadre d’une action judiciaire. Cette chaîne de responsabilité remonte également plus facilement jusqu’au plus haut sommet de l’État qui peut suivre par écrans interposés les interventions. Ces questions se posent avec insistance pour les soldats. Oriane Barat Ginies relevait dans un article rédigé pour l’IHEDN en 2011 le sentiment d’insécurité juridique ressenti par le soldat français, défini comme : « (…) l’absence de protection de l’individu par le droit, du manque d’encadrement de sa mission et de la recherche automatique de sa responsabilité pénale. »[13] Les réflexions entreprises dans le domaine du lawfare doivent accompagner un travail nécessaire d’analyse sur la manière d’envisager la responsabilité pénale.
Les instruments du lawfare
Le lawfare se définit également par des moyens spécifiques qui peuvent être placés dans la typologie suivante :
• Des procédures judiciaires internationales peuvent être engagées. L’instance la plus connue mettant en œuvre une justice dite « globale » est la Cour pénale internationale (CPI). Elle n’est toutefois pas le seul acteur. Les comptes-rendus rédigés par les rapporteurs spéciaux mandatés par les Nations unies, le cas échéant après un conflit, constituent une étape décisive vers la saisie de tribunaux. Ces documents juridiques autonomes viennent en amont du déclenchement d’une procédure à la CPI. Le rapport dit « Goldstone » suite à l’opération Plomb Durci menée par Israël dans la bande de Gaza avait ainsi fait grand bruit. Pour rappel, il conclut que l’armée de défense israélienne comme le Hamas sont responsables de crimes de guerre et possiblement de crimes contre l’humanité. Ces conclusions ont été extrêmement controversées, signe de la politisation actuelle du droit international. L’utilisation de la compétence universelle constitue aussi un recours visant à contourner les États. Ce mécanisme juridique permet de porter un litige dans un tiers pays si le pays visé n’entreprend aucune action juridique. Le cas s’était produit en 2009 pour l’élimination ciblée visant l’un des chefs militaires du Hamas Salah Shehadeh[14]. La compétence universelle a toutefois été aujourd’hui considérablement limitée dans sa portée.
• Des actions en justice peuvent également être menées au sein de juridictions nationales. Pour les États démocratiques, le pouvoir exécutif doit alors se soumettre à l’impératif de « redevabilité » envers le pouvoir judiciaire si ce dernier est saisi. Ici, les exemples nationaux varient : toutes les cours ne font pas preuve du même activisme juridique. Aux États-Unis, la doctrine légale de la « question politique» permet aux cours de se déclarer incompétentes si la question posée conduit à se prononcer sur une politique menée par l’exécutif, au nom de la séparation des pouvoirs. Elles sont néanmoins de plus en plus sollicitées. À ce titre, il faut noter l’apparition d’un nouvel acteur en plus des États, des ONG et des institutions internationales. L’industrie de l’armement est également impactée par le lawfare. Le cadre juridique de contrôle des exportations d’armement est un sujet donnant lieu à de très vifs débats. Les ONG s’attaquent aux industriels exportant des armes afin de faire levier sur les actions des États. Cette nouvelle normativité peut être instrumentalisée par des exportateurs plus puissants dans un domaine compétitif et aux enjeux monétaires considérables.
• Les déclarations de relais d’opinions à travers les médias formulant des accusations d’illégalités. Le lawfare peut également prendre la forme d’un échange d’arguments par médias interposés. Ici, la voix des cours de justice se tait pour laisser place au « tribunal de l’opinion ». Ces actions sont en général sans effet juridique direct et n’aboutissent pas à des condamnations dans les cours. Toutefois, elles sont un ressort décisif pour mobiliser l’opinion. La réputation de l’armée et la légitimité des interventions pour le grand public sont les enjeux de ce type de stratégie.
Deux objections à lever ?
Le lawfare constitue un champ innovant pour la recherche normative sur les pratiques guerrières. Il est placé à l’intersection entre des préoccupations morales – limiter les maux de la guerre en restreignant l’utilisation de la force ; politiques – délégitimer ou légitimer les interventions ; et opérationnelles – identifications des actions pouvant être menées avec efficacité sur le terrain. La discussion sur le lawfare se heurte toutefois à deux objections importantes qui appellent à un débat collectif.
Le lawfare est immoral
Le lawfare a été décrit comme immoral. Comble du cynisme, il s’agirait de détourner le droit à des seules fins de puissance[15]. Il s’agirait de faire ce que nous appelons du legal washing. Modelée sur l’expression de greenwashing, nous l’employons ici pour interroger l’utilisation du droit dans le domaine de la sécurité nationale à des fins de légitimation des politiques existantes. La pratique américaine de la torture dans la prison de Guantanamo avait ainsi déclenché un vaste débat. Le professeur de droit à Harvard Alan Dershowitz s’était prononcé en faveur d’émission des mandats de torture, provoquant l’ire de nombreux chercheurs qui y avaient vu une grave compromission des intellectuels[16]. L’administration américaine avait opté pour une pratique de la torture « légale » qui ne dit pas son nom : les « méthodes d’interrogations renforcées » (« enhanced interrogation techniques »).
Ces critiques sont évidemment très importantes. Cependant, notre intuition est qu’il vaut mieux souvent trop de droit que pas assez. Le rôle institutionnel des juristes dans l’armée est d’éclairer de la lumière du droit les actions de l’État. Aussi frustrant que soit le fait que le droit puisse être utilisé de mauvaise foi, la réponse est probablement une meilleure connaissance des concepts juridiques, des mécanismes visant à les appliquer, des personnes vigilantes et dédiées à son respect.
Le lawfare est non pertinent
Le deuxième faisceau de critiques dirigées à l’encontre du lawfare vient de l’autre bout du spectre politique : pour les « réalistes », il serait non pertinent dans un environnement stratégique où seul compte la matérialité de la puissance. Toutefois, personne ne met en doute le fait que le nombre d’hommes et d’équipements militaires restent les conditions décisives de victoire. Cela n’empêche nullement de reconnaître le lawfare comme une évolution de l’art de faire la guerre. La France risquerait un isolement stratégique si un débat collectif n’était pas mené sur
ces questions.
References
Par : Amélie FEREY
Source : Revue Défense Nationale
Mots-clefs : droit de la guerre, droit international, intervention militaire, lawfare, procédure judiciaire, responsabilité, warfare