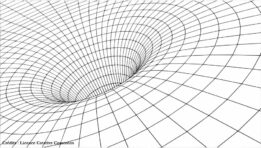L’article « Panel international sur le sortie de la violence ; synthèses des groupes de travail – 2ème partie » présente la suite des travaux des chercheurs regroupés au sein du Panel international sur le sortie de la violence (IPEV), travaux soutenus par le CSFRS. Les synthèses de cette 2ème partie proposent une approche comparative des politiques publiques contre la violence, du lien entre justice et réconciliation, du rôle de l’histoire et de la mémoire pour la sortie des violences de masse et de l’impact de la prise en compte des dimensions psychologiques individuelles et collectives. Ces synthèses sont accompagnées de recommandations émises par les chercheurs ayant contribué aux travaux.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont : Synthèses des groupes de travail – 2 ème partie, conférence de restitution IPEV, Beyrouth 2018, avec Sandrine Lefranc, Eduardo Pizarro, Elisabeth Claverie, Scott Straus et Richard Rechtman
Ce texte, ainsi que d’autres publications peuvent être visionnés sur le site du CSFRS :
Les politiques publiques contre la violence : leçons comparatives
L’énigme dont la résolution a été confiée à ce groupe de travail consistait à élucider ce que sont les « politiques publiques contre la violence », expression choisie par l’IPEV, peu commune dans la littérature spécialisée sur les politiques visant à mettre fin durablement à la violence politique de masse (guerre, guerre civile, répression,
génocide). Il s’agissait de travailler sur l’idée même d’une action politique contre la violence politique et de masse , en même temps que sur la manière dont la violence est qualifiée comme problème. Est-il possible, et si oui à quelles conditions, de mener une politique volontariste de sortie de conflit ouvert en vue d’établir une paix durable ? Quel « problème » entend-on résoudre à cette occasion, et dans quelle mesure cette qualification de cette violence, inéluctablement politique, est-elle conflictuelle ? A ces deux questions suscitées par une approche de la violence politique en termes de politiques publiques s’ajoutait une troisième interrogation sur la centralité de l’État national dans ce domaine d’action privilégié d’autorités internationales, publiques et privées.
Parmi les différentes politiques publiques contre la violence politique qu’il était possible d’analyser, nous nous sommes concentrés sur celles qui, accessibles aux compétences des membres du groupe, n’étaient de surcroît pas traitées par les autres groupes de travail : la catégorie globale de justice transitionnelle, les politiques de démobilisation et réintégration des combattants, les politiques foncières, les réparations aux victimes, etc. Nous avons associé des études de cas nationaux (particulièrement latino-américains), des synthèses comparatives et des analyses plus réflexives sur le rôle des experts.
Trois pistes
La portée générale de l’expression « politiques publiques contre la violence » nous a, en premier lieu, incités à être attentifs à la possible continuité entre ces politiques contre la violence et l’action publique en général . Rien ne nous permet en effet d’affirmer qu’un pouvoir, lorsqu’il produit ou co-produit des politiques publiques contre la violence politique, utilise des moyens spécifiques, sans rapport avec des mesures prises contre des violences domestiques ou avec toute autre politique publique. La réflexion a été guidée par ce souci de ne pas déduire ex ante la spécificité des politiques publiques contre la violence d’une exceptionnalité elle aussi supposée des périodes de violence [1], ou d’un état supposé anormal ou pathologique des sociétés en conflit violent (par opposition à un état supposément normal des sociétés en paix). Les propositions politiques des experts sont en effet trop souvent déduites d’une dichotomie entre guerre et paix dont on sait désormais qu’elle ne va pas de soi. Les « entre-deux » dominent [2]. Les études des processus de justice transitionnelle omettent pareillement trop souvent de noter à quel point l’État « nouveau » est l’héritier direct de l’État violent : ses règles de droit, ses politiques publiques, ses institutions, ses réseaux sociaux et sa fonction publique ; les « purges » sont rares.
En deuxième lieu, nous sommes partis du constat que les organisations internationales interviennent massivement, et à différents moments, au travers de missions d’observation à la suite d’un accord de paix ou d’interposition plus active entre belligérants ( peacekeeping ), de facilitation d’accords de paix ( peacemaking ) ou encore d’opérations à plus ou moins grande échelle de construction de la paix ( peacebuilding ). L’approche top down employée est généralement associée à une démarche de problem solving – parfois ethnocentrique – où le raisonnement consiste à évaluer le résultat d’une politique publique, en termes de succès ou d’échec, sur la base des intentions proclamées de la « communauté internationale ». À rebours de ces approches top down , il convient d’opérer le même déplacement analytique que celui réalisé en théorie des politiques publiques et ayant conduit au développement d’une sociologie politique de l’action
publique [3]. Il faut donc passer du « diagnostic de l’échec des politiques publiques » — jugées tout à la fois ineffectives, inefficaces et inefficientes — « à la compréhension de leur mise en œuvre » et centré dorénavant la réflexion sur « l’articulation régulation sociale /régulation politique » [4]. Une approche relationnelle permet ainsi de rendre compte de la façon dont les acteurs internationaux en charge des politiques de paix interagissent avec les acteurs locaux et ce notamment en fonction de l’agenda propre de ces derniers, lequel se trouve toutefois reconfiguré du fait de la présence internationale. De la sorte, on parvient à dépasser la dichotomie international/local trop souvent présente dans les analyses de peacebuilding et l’on se donne les moyens de mettre à jour le rôle des « courtiers » et experts qui, s’agissant des contextes de sortie de conflit, peuvent être envisagés comme intermédiaires de la paix. En troisième lieu, et dans la continuité de ce qui précède, nous avons voulu insister sur l’importance d’une sociologie des acteurs des politiques publiques de sortie de la violence. Si les politiques contre la violence sont des politiques comme les autres, qui empruntent des aspects et des techniques avec des politiques publiques a priori sans rapport aucun avec le conflit, c’est aussi parce que ceux qui les conçoivent, les mettent en œuvre, les évaluent, circulent : d’un pays à l’autre, d’un secteur à l’autre, d’une période de l’histoire à l’autre. Les politiques post-conflit sont de ce point de vue une forme banale d’action publique. Elles ne consistent jamais en l’action solitaire des gouvernements, des Etats, mais sont une co-production des différentes acteurs sociaux et politiques, des mobilisations variées. Ce sont par ailleurs moins les contenus de ces
politiques que leurs appropriations qui sont décisives.
Il faut donc s’interroger, en scientifiques prenant le temps de décrire les situations, sur ce que font les acteurs des politiques contre la violence : gouvernements, bien sûr, agents des organisations internationales, mais aussi et de manière importante des experts circulant entre universités, think tanks , ONGs, organisations internationales et gouvernements. Observer ces pacificateurs permet de mieux comprendre ce qui est fait dans le cadre des politiques (de la même manière qu’on comprend mieux ce que font certaines administrations des États contemporains en constatant que leurs agents ont eu précédemment une expérience coloniale). Cela permet par ailleurs de cerner l’action de ces politiques publiques contre la violence au-delà du contenu des programmes, c’est-à-dire notamment quels jeux elles permettent de jouer : quels rapprochements politiques ou quelles reconfigurations des hiérarchies sociales elles autorisent, qui se les approprie (sont-ils puissants, nombreux, socialement situés ?, questions posées par exemple en ce qui concerne les politiques de démobilisation).
Réconciliation et justice : leçons comparatives
Notre groupe de travail, « Justice et Réconciliation », est un groupe multidisciplinaire, puisqu’il compte sociologues, anthropologues, politistes, juristes et philosophes. Cette équipe a dirigé ses travaux vers la question des « solutions » post-conflit spécifiquement orientées vers la mise en œuvre de dispositifs de justice, qu’il s’agisse de dispositifs proprement judiciaires, internationaux ou nationaux, ou qu’il s’agisse de la mise en place de configurations parajudiciaires. Ces dernières, qui n’engagent pas le jugement de magistrats professionnels ni de procédures et de corpus juridiques, privilégient plutôt des protocoles d’aveux devant des assemblées de « sages », en présence ou non des victimes et de leurs proches. Il en est ainsi des divers types de commissions Vérité et Réconciliation dont l’Afrique du Sud a été le modèle (ici, l’instance « Équité et Réconciliation » du Maroc), ou des agencements néo-traditionnels, comme les Gacaca au Rwanda, par exemple, etc. Ces formes sont moins axées sur des modèles de justice rétributive que sur des solutions dites restauratrices, dont les soubassements principiels sont souvent hérités de principes religieux ou d’adages de sagesse. Plutôt que la punition des auteurs de crimes, ils visent « la restauration du tissu social ». Les solutions judiciaires nationales ou internationales comme la CPI (Cour pénale Internationale) ont quant à elles souvent été obtenues de haute lutte, et souvent en contestant les politiques d’amnistie, au nom de la « lutte contre l’impunité », prônée dans l’agenda international des années 90.
Les diverses justifications et appuis normatifs de ces différentes conceptions de la justice et du retour à l’ordre ont donc été analysés et contextualisés à travers une série d’études de cas (Maroc, Liban, Chili, Argentine, Guatemala, Pérou, Colombie, ex-Yougoslavie, Brésil, République Démocratique du Congo). Il s’est vite avéré que des travaux sur la justice transitionnelle impliquaient une analyse située des fréquentes situations locales d’amnistie. Ainsi, plusieurs de nos analyses se sont-elles organisées autour de la polarité « amnistie vs justice » et de l’évolution de ces situations, et se sontelles focalisées sur leurs arguments politiques respectifs, s’agissant surtout des pays d’Amérique latine. Tablant sur la nécessité pratique d’un oubli volontaire collectif et partagé pour maintenir la paix, nombre d’États en situation de post-conflits ont en effet érigé l’amnistie en instance transitionnelle , forme de justice par défaut, obstruant alors toute possibilité de recours judiciaire contre les auteurs de crimes consubstantiels à ces conflits, Ces mesures gouvernementales, a-t-on pu observer, peuvent aller de l’amnistie totale à des systèmes d’amnisties partielles, ou encore à des mesures de grâce ou d’annulation des décisions judiciaires qui pouvaient avoir déjà eu lieu. En promouvant l’oubli, la convention d’amnistie établit un pacte, sorte de récit fictionnel, selon lequel c’est le tissu social lui-même qui doit être considéré comme la victime de violations, plutôt que tel ou tel groupe social ou ethnique qui prétendrait avoir été spécialement « ciblé ». Dans certains cas, ce calcul politique compose une péréquation à somme nulle des actes criminels de chacune des parties au conflit, opération considérée comme devant recouvrir, au nom du bien commun, les faits et leurs auteurs d’un voile d’ignorance. Ignorance que des tentatives d’institutionnalisation locales de la mémoire, essaient ici et là, quand elles sont permises, de compenser en partie.
De nombreux contributeurs/trices de notre groupe se sont ainsi attachés à montrer les dynamiques d’émergence, dès les années 80 et 90, des processus de remise en cause de ces mesures d’amnistie, considérées par nombre de mouvements de mobilisation de la société civile comme étant des « autoamnisties », étudiant alors les modes de justification locale de ces diverses mesures internes d’amnistie. Dans plusieurs de ces États, l’émergence de procès judiciaires ou de dispositifs innovants de justices restauratrices, fruit de luttes sociales, ont pu voir le jour, et ont été indexés à un désir public de
vérité, vérité factuelle qui serait issue d’enquêtes garanties par un droit démocratique.
Des situations post guerre civile, comme celles du Liban, avec le règlement inter communautaire des accords de Taëf accompagnés de mesures d’amnistie a, elle aussi, été étudiée. Deux types de revendications sont en effet à l’œuvre : ceux qui favorisent plutôt une réconciliation fondée sur « le pardon » et « l’oubli » considérés comme des garants de la paix, de la stabilité sociale et de l’unité nationale. Cette sphère de justification, celle de certains États successeurs aux régimes autoritaires, en Amérique latine notamment, met en avant le risque que comporteraient les solutions judiciaires, celui de « raviver les haines du passé ». Les revendications anti-amnistie, deuxième type de revendication opposé au premier, sont souvent des demandes sociales de justice, revendiquant des dispositifs de jugement (formels ou non) en tant que dispositifs d’établissement de la vérité, accolé au thème, de « la lutte contre l’impunité », selon le slogan « pas de paix sans justice » lui-même porté par le droit humanitaire international. La confrontation publique avec les situations d’amnistie, notamment les amnisties totales et leurs systèmes de justification, a donc été centrale pour établir nos cas, à travers des analyses sociohistoriques retraçant depuis trente ans les avatars et les temporalités de ces situations polarisées.
D’autres travaux de notre groupe se sont centrés sur le choix de solutions pénales en
appui aux opérations de transition post-conflits armés, et leur essor, sous diverses formes, nationales, internationales ou hybrides à partir des années 1990, et, partant, des évolutions et de l’influence du droit international humanitaire. Sont étudiées ici aussi bien la question de la diffusion des incriminations de « crimes de guerre », « crimes contre l’humanité » et « génocide », que celle du caractère individuel de la responsabilité pénale des auteurs, la promotion d’un droit dans la guerre, y compris dans les conflits armés internes (les guerres civiles), et non plus d’un droit applicable seulement dans le cadre de conflits armés internationaux. Ces procès, nationaux et internationaux, sont ici analysés aussi dans leur rôle documentaire dans la description et l’analyse des conflits armés contemporains, et leur valeur historique potentielle.
Analyses
Notre groupe, (dans une démarche de sciences sociales) a conduit ses recherches sur les processus du post-conflit et les évolutions politiques qui les ont accompagnés et marqués, puisque les dispositifs envisagés étaient indexés sur des visions politiques et sociétales des régimes successeurs aux dits conflits, qu’il se soit agi de conflits armés ou de violences politiques d’Etat et de système de répression politique. Nous nous sommes surtout intéressés, parmi ces dispositifs de sorties de conflits, aux dispositifs de justice, judiciaires ou non, à ce qu’on a appelé « la justice transitionnelle ».
◆ Parmi ces dispositifs, ont été observé la mise en œuvre (difficile) des commissions (appuyées sur le modèle de la commission « Vérité et Réconciliation sud-africaine), arguant de la nécessité de justice, mais entrant en composition avec d’autres éléments tendant à limiter les demandes publiques (un certain public) de vérité
(le cas de la Tunisie).
◆ Ont été observés et analysés, notamment dans plusieurs pays d’Amérique latine, des phénomènes de revendications sociales massives pour l’abrogation des mesures d’amnistie, réclamant, dans le sillage des politiques de sensibilisation du droit international humanitaire, de la lutte contre l’impunité, des procès contre les principaux responsables. Ces luttes ont publicisé des répertoires de déconstruction des arguments justificatifs allégués (en Amérique latine) par les promoteurs de l’amnistie, et rendus possibles la tenue de procès nationaux, sur la base d’incriminations définies.
◆ Dans d’autres cas (Liban, par exemple), les jeux d’équilibres entre mesures d’amnisties, accords communautaires, désirs d’éviter la reconduction infinie de représailles, peut générer certaines tensions, que des politiques de mémoires pourraient atténuer, mais éviter le pire.
◆ D’autres techniques de justice (accès à plus de justice sociale foncière), fruit de négociation post-conflit, ont aussi, en Colombie, attaché la redistribution de terres (mais terres isolées et non aménagées) aux ex-miliciens des FARC comme signe d’une reconnaissance (jusqu’à un certain point, ces terres étant isolées) de la question foncière et de la question des inégalités.
◆ Enfin, ont été analysés les effets de la judiciarisation des conflits armés et, partant, la diffusion des normes du droit humanitaire international (avec l’introduction du Statut de Rome), mais aussi les descriptions qu’elles offrent de nombre de conflits armés contemporains et de leur organisation. Les procès de ces juridictions internationales, et des procédures engagées au niveau des Etats au titre du Statut de Rome, ou, plus généralement, de la compétence universelle.
◆ Enfin, une réflexion sur la question de la définition normative de la justice transitionnelle a été engagée.
Préconisations : mises en place d’enquêtes
◆ Il semble urgent pour les sciences sociales de mettre en œuvre des enquêtes sur la réception de ces dispositifs, s’agissant notamment des collectifs de réception organisés au sein de la société civile, (quand elle existe) auprès d’ONGs locales, par exemple, et de partis politiques.
◆ Il semble urgent de se donner les moyens de décrire des situations empiriques dans lesquelles, (comme il est fréquent aujourd’hui) plusieurs normes de justice cohabitent. (Comme par exemple des fragments de mesures d’amnistie voisinant avec des procédures de renvoi devant la Cour internationale, mais aussi recours à des dispositifs néo-traditionnels (type gacaca), procès nationaux, pourparlers de paix.
◆ Il serait important aujourd’hui de dresser une « carte » des argumentaires situés en matière de défense ou de critiques de chacun de ces dispositifs, amnistie y compris.
Le rôle de l’histoire et de la mémoire dans la sortie des violences extrêmes et des violences de masse : leçons comparatives
Usages et mésusages de la mémoire
Les projets qui commémorent la violence à grande échelle peuvent contribuer à une sortie de la violence, mais ils peuvent également alimenter les dynamiques destructives à l’origine de celle-ci. Notre groupe de travail est composé de chercheurs dont les domaines de spécialisation incluent des projets de mémoire qui reflètent ces deux
potentiels. À travers nos présentations et nos échanges, nous avons voulu isoler les éléments des projets de mémoire qui contribuent à une « sortie » de la violence, ainsi que ceux qui pourraient entraver ce processus, et nous nous sommes appliqués à documenter collectivement des théories qui se vérifient pour chacun de nos divers exemples.
La violence à grande échelle marque le paysage humain, physique et social. Bien après que les plaies aient été ouvertes, ces cicatrices littérales et figurées imprègnent le passé d’une signification contemporaine, et parfois d’une dimension d’urgence. Dans bien des contextes, les États, les acteurs de la société civile et les individus y répondent en créant des espaces et des objets pour commémorer le passé. Nous appelons ces créations des « projets de mémoire ». Dans leur forme la plus élémentaire, de tels projets viennent en aide à ceux qui ont souffert et sont une source de guérison, de catharsis et de commémoration pour les survivants et leurs proches.
La commémoration publique de violences sociales et politiques, en revanche, n’est jamais aussi simple. Les projets de mémoire publics sont appelés à remplir un rôle plus large que celui de monument aux morts. Il s’agit presque systématiquement de constructions hautement symboliques qui composent une narration implicite ou explicite du passé. En présentant un récit du passé, les projets de mémoire transmettent des paraboles sur le bien et le mal qui reflètent et débordent inévitablement sur la politique et les relations de pouvoir. Le travail de mémoire est une arène litigieuse et oppressante, et non pas un monument aux victimes innocent et prépolitique.
En occupant l’espace public, politique et social, le travail de mémoire peut, quoique ce ne soit pas toujours le cas, montrer aux victimes que la société et l’État reconnaissent leurs pertes, et par le biais de cette reconnaissance, porter la promesse de ne « plus jamais » laisser l’histoire se répéter. La commémoration peut délivrer une puissante mise en garde sociopolitique contre la possibilité et les risques des abus de pouvoir en exposant comment les États et les peuples ont été capables de perpétrer les pires calamités. Les projets de mémoire peuvent être utilisés pour composer un récit
commun d’un passé controversé, mais aussi pour aider des groupes à voir ce passé d’une perspective extérieure à leur histoire personnelle ou communautaire. La reconnaissance mutuelle d’un passé violent peut être la clé pour imaginer un futur sans conflits. De surcroît, les projets de mémoire peuvent présenter l’occasion d’un dialogue démocratique sur le passé et l’utiliser comme un tremplin pour discuter du présent et du futur. Ainsi, bien que les mémoriaux soient presque inévitablement controversés, ils peuvent contribuer à changer le cadre qui avait initialement généré et attisé la violence et la division dès lors qu’ils permettent des formes pacifiques d’interaction et de débat sur des expériences passées profondément douloureuses.
Pourtant, les projets de mémoire ne sont pas systématiquement des lieux propices à la discussion, à la compréhension mutuelle et à la transmission efficace des nomes de maintien de la paix. Au contraire, ils peuvent causer ou alimenter les désaccords, la division et polarisent les sociétés au sortir de la violence ; ils deviennent alors des symboles de l’incompréhension mutuelle et du manque de respect. En réifiant certaines expériences et certaines histoires et en attribuant à des groupes sociaux entiers les rôles fixes de victimes et de responsables, les projets de mémoires peuvent renforcer de profonds clivages sociaux. Quand les projets de mémoire sont liés à l’État, ils peuvent devenir des outils de pouvoir qui servent dans certains contextes à marginaliser et déposséder, plutôt qu’à guérir et rassembler. Même lorsque la mémoire ne suscite pas directement la division, les projets peuvent être mis en place de telle sorte qu’ils reflètent simplement le statu quo, se faisant ainsi passer pour et se substituant à d’autres formes d’actions politiques. Les projets de mémoire conçus dans cette optique sèment le trouble, ce sont des gestes symboliques qui déraillent les conversations sur les réformes structurelles fondamentales qui pourraient atténuer les répercussions écrasantes de la violence (telles que les dépossessions matérielles, les inégalités profondes, ou d’autres formes de spoliations). Les projets de mémoire peuvent alors semer les graines d’un retour à la violence.
En résumé, notre groupe reste prudent au sujet des contributions possibles de la mémoire à la sortie de la violence. Le travail de mémoire n’est pas un terrain innocent dans lequel le seul ou le principal impératif serait de mobiliser la volonté et les fonds. La mémoire travaille d’une myriade de façons dans le sillage de la violence, et tout particulièrement de la violence de masse, à laquelle nous nous intéressons. Le contexte joue énormément : les contributions sociales et politiques des projets de mémoire dans un contexte donné peuvent changer du tout au tout dans un autre, et au fur et à mesure du temps. Conscient de la diversité de ce terrain et sensible aux spécificités contextuelles, notre groupe a affiné sa problématique : quelles sont les caractéristiques des projets de mémoire qui contribuent à créer un espace public démocratique et non violent permettant à la contestation et au désaccord de s’exprimer pacifiquement ? Nous reconnaissons qu’il est intrinsèquement difficile pour n’importe quel projet d’adhérer à ces principes, compte tenu des cicatrices sociales et personnelles extrêmement douloureuses que laisse la violence de masse. Les projets de mémoire
qui contribuent véritablement à la sortie de la violence susciteront la controverse. Dans nos diverses études de cas, et au cours de nos délibérations, nous avons isolé six attributs constitutifs d’une « éthique de la mémoire » qui permettrait à notre avis de contribuer significativement à une sortie de la violence ; en voici la synthèse.
◆Autoréflexion des politiques de la mémoire . La mémoire est souvent présentée comme apolitique, au service du récit de l’expérience de victimes innocentes. Pourtant, nous avons vu encore et encore combien la mémoire et le pouvoir sont étroitement liés. Les projets de mémoire sont invariablement politiques. Bien souvent, les mémoires officielles servent à réifier l’expérience de certains pour justifier la répartition du pouvoir et polariser les sociétés – souvent à travers un
discours qui réduit la mémoire à sa dimension éthique et occulte sa nature politique. Nous encourageons donc les projets de mémoire, ou ceux qui en sont responsables, à promouvoir une autoréflexion sur les implications de leur travail de mémoire. Sous couvert de commémoration, de tels projets s’entrelacent fréquemment avec le pouvoir, ce qui ajoute une responsabilité supplémentaire. Simultanément, les projets de mémoire doivent rester attentifs à ne pas essayer de se substituer à d’autres formes de politiques et de restitutions. C’est là une limite des projets de mémoire. Les domaines de guérison importants doivent trouver d’autres outils de réponse : le travail de mémoire n’affecte pas bien des aspects essentiels de la vie sociale et politique au sortir de la violence. Les projets de mémoire n’offrent pas de solution à la violence structurelle, aux inégalités profondes, aux privations matérielles, à l’exclusion politique vécue au quotidien, et autres retombées. Si les projets de mémoire doivent donc tendre à l’autoréflexion sur le pouvoir qu’ils exercent et les conséquences de leur action, il leur faut de la même manière encourager une autoréflexion sur leurs limites, à savoir les domaines où ils ne doivent ni agir, ni s’impliquer.
◆Créer un espace respectueux où l’on reconnaît et accompagne le recueillement de ceux qui ont souffert de violences passées . Les projets de mémoire sont au premier plan des efforts de reconnaissance des pertes individuelles et personnelles résultant d’une violence politique antérieure. En offrant un espace public et officiel de récognition, les projets et le travail de mémoire parviennent le plus souvent à créer un espace de recueillement et de reconnaissance. Ils donnent une visibilité aux expériences et à la violence précédemment indiscernables, et peuvent ainsi aider les
individus et les sociétés à tourner la page.
◆Briser les silences. La mémoire renforce. L’expérience nous a démontré que le travail de mémoire à encourager est celui qui officialise et met en exergue des points de vue jusque-là peu reconnus, voire délibérément étouffés. La mémoire contribue alors à la sortie de la violence en permettant l’émergence de différentes perspectives sur la violence passée. Dans bien des cas où les projets de mémoire ont pu intervenir de façon significative, la violence de masse contre des catégories de population avait été précédemment ignorée, voire activement étouffée.
◆Encourager la discussion démocratique. Après la guerre, le conflit se transpose du champ de bataille au sens propre à celui de la mémoire. Dans bien des cas, les projets de mémoire reforment les lignes de fracture et mènent à des incompréhensions mutuelles. Ceux d’un côté d’un conflit voient l’histoire d’un certain point de vue, et leur adversaire d’un autre. La lutte entre les mémoires est inévitable. On peut donc ériger en principe directeur la stimulation du dialogue. Les groupes qui s’affrontaient auparavant ne devraient pas chercher à se voir réciproquement comme des ennemis, mais plutôt comme des adversaires qui partagent un espace public commun non violent, bien que conflictuel. Dans ce contexte, il leur faut s’efforcer d’écouter l’autre.Les projets de mémoire ne doivent pas cultiver un dialogue de sourds, mais aspirer à créer des espaces de découverte, d’apprentissage et de conversation, tout en reconnaissant simultanément les expériences des victimes du passé ; les projets de mémoire devraient être démocratiques et fondés sur une orientation intellectuelle réfléchie, et non pas dogmatiques
◆Viser une reconnaissance mutuelle . Les projets de mémoire « demandent » implicitement quelque chose des responsables ou de leurs successeurs. Parfois, ceux qui ont perpétré la violence maintiennent le bien-fondé de leurs actions, ou leur innocence. Toutefois, devrait-on adopter comme ligne directrice la culture de l’empathie et la reconnaissance des souffrances ? Viet Thanh Nguyen écrit que « toutes les guerres ont deux champs de bataille, le premier se joue sur le terrain, le second dans la mémoire »[5]. Il défend une « mémoire juste », une éthique de la mémoire qui « aspire à se souvenir simultanément de sa propre expérience et de celle des autres, tout en sensibilisant au cycle de vie des mémoires et à leur production industrielle, à la manière dont elles sont façonnées puis oubliées, dont elles évoluent et changent »[6].
◆Reconnaître les changements au fil du temps . Dans le monde d’aujourd’hui, le langage de la mémoire est omniprésent, la mémoire reflète donc les compréhensions actuelles. Cependant, de même que les projets de mémoire doivent éviter de cantonner les victimes au statut de victime, ils gagnent du sens et de la valeur quand on leur permet d’évoluer au fur et à mesure du temps. Le processus de sortie de la violence implique que les victimes acquièrent du pouvoir ; ils deviennent à la fois rescapés et citoyens. Même si les plaies ne guérissent jamais, le travail de mémoire ne devrait pas forcer des groupes sociaux entiers à n’être définis que par une expérience de victimisation, car ce statut de victime porte nécessairement l’empreinte de la violence à son origine. Après une période de recueillement et de récognition, au cours du temps, vient un moment où le travail de mémoire peut commencer à dépasser la dialectique de victime/responsable de façon à désamorcer, plutôt que de renforcer, les animosités du passé.
Se reconstruire : leçons comparatives
Depuis le milieu des années 1990, on assiste à l’émergence d’une nouvelle exigence sociale et politique de réparation psychologique des victimes des conflits majeurs (guerres, coups d’état, épurations ethniques, génocides …). En effet, particulièrement dévastateur pour les populations civiles, ces conflits ont cruellement posé la question des séquelles psycho-traumatiques des victimes directes et indirectes, et parfois aussi des auteurs d’atrocités. Au regard des politiques globales de réparation, ces questions sont progressivement devenues cruciales. Certes, l’enjeu a d’abord été individuel puisqu’il s’agissait de trouver les solutions susceptibles de permettre à chacun de se réparer, d’abord, pour retisser, ensuite, les liens sociaux brisés par la guerre et les violences. Mais l’objectif est rapidement devenu bien plus ambitieux et surtout bien plus politique que simplement sanitaire. Comment faire coexister pacifiquement des hommes et des femmes que tout séparait quelques temps auparavant, comment éviter que les plaies des uns et des autres ne s’ouvrent de nouveau devant l’impossibilité, pour chacun, de se satisfaire des seuls discours de réconciliation? Autrement dit, comment éviter que l’aspiration à la vengeance ne se nourrisse du sentiment, souvent partagé par les victimes que la justice n’estompe pas nécessairement les haines. La plupart des pays engagés dans un processus de réconciliation, comme les plupart des agences internationales et non gouvernementales travaillant à leurs côtés ont fait le pari de mettre en place des dispositifs susceptibles de prendre en charge, d’écouter et de soigner les plaies psychiques — c’est-à-dire les traumatismes de la guerre et des violences — avec l’espoir de permettre aux hommes et aux femmes meurtries par les guerre et les violences d’être de nouveau capable de revivre ensemble, à défaut
d’exiger d’eux qu’ils pardonnent ou oublient.
L’institutionnalisation de dispositifs susceptibles de prendre en compte les dimensions psychologiques individuelles et collectives présente au moins deux avantages sérieux. Le premier consiste à apporter une écoute et des réponses singulières pour chacun, là où la justice élude les questions singulières au profit d’une volonté de prendre en compte la totalité de la société, ou tout au moins le plus grand nombre. C’est d’ailleurs une des plaintes régulières des individus, reprochant à la justice d’avoir ignoré leurs attentes. Or, l’accent mis sur les plaintes psychiques et les souffrances singulières apporte à chacun, et donc à tous, le sentiment d’être enfin entendu. Le second avantage consiste dans le renforcement d’un récit collectif (ou national selon les cas) au sein duquel même ceux qui ont le plus perdu trouvent une expression légitime. C’est par ce biais que la mémoire collective pourra aussi se fonder sur une narration traumatique permettant à chacun d’inscrire son histoire personnelle dans le récit collectif. C’est dire à quel point ces nouveaux dispositifs sont aujourd’hui essentiels pour envisager une sortie de la violence, ils démontrent comment la prise en compte de l’individuel voire du plus singulier est aujourd’hui une des modalités de réparer et de réconcilier le
collectif. Alors que la plupart des autres dispositifs de sortie de la violence fonctionnent de façon inverse, c’est-à-dire, en privilégiant la réponse collective, voire globale, avec l’idée que les individus finiront bien par y trouver leur compte, les dispositifs psychologiques proposent une approche par la base ( bottom up ) qui remonte jusqu’au collectif en proposant une narration collective des souffrances endurées.
Comme première recommandation, il nous semble indispensable de favoriser la juxtaposition des processus top down (comme la justice internationale, l’institutionnalisation d’un récit national etc.) et bottom up (la prise en compte des souffrances de chacun) au sein des perspectives de sorties de la violence. Les recommandations suivantes découlent de l’analyse des différents dispositifs de réparation psychologique que nous avons étudiés. Il nous est apparu essentiel de distinguer deux types majeurs de dispositifs qui mériteraient d’être mis en place dans le cadre des processus de
sortie de la violence:
◆Les dispositifs de restauration du self : ce sont tous ceux qui sont centrés sur la prise en charge psychologique des conséquences de la violence (subie ou agie) qu’il s’agisse du trauma (PTSD), de la prise en charge des violences sexuelles et des enfantements forcés, de la torture, des enfants soldats, etc. ou encore des dispositifs dits thérapeutiques réunissant bourreaux et victimes. La restauration psychologique passe ici par l’idée d’une réparation subjective d’un trauma singulier caractérisant néanmoins un destin collectif. Ils reposent sur la mise en place de lieux de prises en charge individuelles, familiales et collectives, grâce à des approches cliniques et psycho-sociales. Cela suppose la formation de personnels locaux qualifiés et le développement de pratiques scientifiquement validées. Centrés sur la parole victimaire, ces dispositifs ont pour principal objectif de permettre aux victimes d’être à la fois reconnues dans leur douleur et d’être accompagnées et traitées, mais de pouvoir simultanément s’extraire de cette seule posture victimaire afin de s’inscrire dans l’espace social en position d’acteur de la sortie de la violence.
◆Les dispositifs de restauration de l’espace social entre les morts et les vivants. La plupart des processus de violence extrême, notamment les génocides, ambitionnent de faire disparaître le défunt au seul profit du cadavre. Il en est ainsi de la déshérence des corps, de leur abandon dans des fosses communes, de l’interdiction des rites funéraires, comme des disparitions d’opposants, qui toutes privent délibérément les vivants de leurs morts. L’enjeu ici n’est pas seulement de tuer en grand nombre mais aussi, si ce n’est surtout, de rendre impossible tout maintien des liens cultuels et rituels entre les morts et les vivants. En effet, priver les vivants de leurs obligations envers leurs défunts participe de l’ambition et des modalités pratiques des violences de masse. Ici, les dispositifs de reconstruction du self passe par le ré-adressage du corps mort dans l’espace des défunts. Qu’il s’agisse de la restitution des corps aux familles, de la recherche des traces ADN, ou des exhumations des fosses communes pour permettre des inhumations nominatives, toutes ces approches assignent à la restauration individuelle des rites funéraires la fonction de réparation collective. A ce titre, il est indispensable que dans le cadre des processus de sortie de la violence, les autorités légitimes accompagnent l’ensemble des initiatives qui visent à exhumer les corps pour les rendre à leurs proches.
References
Par :
Source : Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques
Mots-clefs : justice, mémoire, réconciliation, reconstruction, Violence