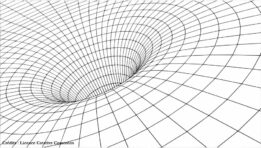Avec cet article, l’auteure nous propose un éclairage sur la combinaison politique-stratégique-tactique, au cœur de l’équilibre des principes qui cadrent la guerre en tant qu’acte politique, avec l’exemple du conflit en Irak sur la période 2003-2011. Elle souligne se faisant l’importance clef d’une stratégie pertinente a priori, stratégie qui devra savoir s’adapter a posteriori, au fil de l’interaction avec l’Autre.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont: « La Guerre d’Irak (2003-2011) : une guerre gagnée, une paix perdue » par Cécile Bonodot.
Ce texte, ainsi que d’autres publications peuvent être visionnés sur le site de l’Ecole de Guerre
L’invasion puis l’occupation de l’Irak par les Etats-Unis ont concomitamment démontré leur capacité de renverser un ordre politique préétabli comme leur difficulté d’en construire un nouveau à leur profit. Le postulat de la présente note de recherche consiste à interroger l’importance cardinale d’une planification pertinente a priori et son adaptation a posteriori.
La présence militaire américaine en Irak a duré près d’une décennie, d’abord au titre de force occupante (2003-2008), puis en tant que force restauratrice d’un gouvernement irakien fragilisé par la chute du régime et la guerre civile qui s’ensuivit (2008-2011). Cependant, initialement, l’occupation était pensée dans une logique court-termiste. La campagne militaire américaine débute le 19 mars 2003, Bagdad tombe le 9 avril et le 1er mai, la bannière Mission accomplished est brandie sur le porte-avion nucléaire USS Abraham Lincoln duquel le président George W. Bush annonce la fin des opérations de combats majeures. L’autorité provisoire créée se donne pour mission de doter l’Irak d’un gouvernement démocratique, stable et allié des Etats-Unis. Pourtant, l’inattendu se produit : une longue campagne de guérilla et de résistance, une scission entre les factions irakiennes qui brouille les alliances, et la venue de nouveaux acteurs qui tirent à leur avantage le concept d’État fragile, les organisations terroristes. Après trois années d’impasse, durant lesquelles processus de reconstruction des institutions, de fragmentation du paysage politique et d’explosion de la violence se cumulent, les militaires américains adoptent une nouvelle stratégie. À l’escalade militaire se substitue une amélioration de la sécurité, permettant graduellement de renforcer le gouvernement irakien, autorisant ainsi, un retrait progressif des troupes américaines.
La contradiction entre une stratégie de guerre limitée et une « éternisation » du conflit
Les Américains ont été partagé entre la logique d’une guerre totale et celle d’une guerre limitée.
La distinction entre les deux logiques de guerre totale et de guerre limitée s’inscrit dans un contexte stratégique particulier. Une guerre totale désigne un conflit armé qui mobilise toutes les ressources disponibles de l’État pour remporter la victoire. Une guerre limitée se caractérise par l’alignement entre des intérêts, des objectifs et des moyens limités.
Dans le cas de la guerre d’Irak, le caractère limité des objectifs politiques et militaires a vite été dépassé d’abord par la rhétorique des décideurs politiques, fixant un but ambitieux et flou de construire un Irak démocratique, stable et allié des Etats-Unis, engagés dans la guerre contre le terrorisme, puis par l’irruption de plusieurs adversaires usant de moyens irréguliers dans le cadre d’une stratégie d’attrition et dont le principal effet a été d’accroître les coûts de l’intervention. L’écart entre les objectifs proclamés et les moyens mis en oeuvre d’une part, entre les gains attendus et les coûts de plus en plus élevés d’autre part, a conduit à une incohérence stratégique. En d’autres termes, décideurs et exécutants ont senti la nécessité d’un retrait, cohérent avec le caractère limité des intérêts, tout en poursuivant l’occupation et les efforts de stabilisation, cohérents avec le caractère absolu des enjeux aussi bien pour les acteurs politique de Washington que les acteurs militaires sur le terrain. Les Américains en Irak sont demeurés dans une logique de guerre limitée, observable à travers les moyens relativement peu importants mis en oeuvre. La guerre limitée adoptée répond à une culture stratégique qui valorise la victoire décisive et la croyance en un conflit expéditionnaire.
Du côté politique : une stratégie de stabilisation non priorisée ou le défaut de flexibilité stratégique
Comprendre l’action des militaires américains nécessite en premier lieu de s’intéresser à la manière dont la stratégie est formulée. En effet, même sans postuler un lien entre la décision politique, la formulation stratégique et l’application tactique, il paraît évident au premier abord que les militaires déployées en Irak ont agi en fonction des décisions prise à Washington.
Or, le processus stratégique est par nature itératif, il doit tenir compte des évolutions du contexte et de la stratégie de l’adversaire. Le processus stratégique est lié à l’incertitude. Comme le souligne l’historien Marcus Jones au sujet de la stratégie bismarckienne : « dans un monde où les résultats restent indéterminés, une stratégie compétente ne consiste pas à fixer des objectifs de long terme et à structurer systématiquement des procédures pour les réaliser, mais plutôt dans une appréhension claire de ses propres principes et priorités associée à une approche flexible et créative afin de produire des gains cumulatifs sur le court terme »[1]. Autrement dit, un objectif nécessite une grande flexibilité stratégique.
Cependant, dans le cas de la stratégie adoptée par les Etats-Unis en Irak, ce mode de raisonnement semble avoir fait défaut. Les adaptations ont été essentiellement tactiques et l’approche générale a peu évolué jusqu’en 2007. Dans une perspective critique le journaliste Bob Woodward pouvait ainsi légitimimement intituler l’un de ses ouvrages paru en 2006 State of Denial quand le journaliste Thomas Ricks choisissait de parler de « fiasco » pour décrire l’aventure militaire américaine en Irak[2].
Les choix effectués au début d’un conflit restreignent le champ des possibilités et orientent les actions ultérieures. S’agissant de l’opération américaine en Irak, deux élements ont ainsi orienté la campagne : l’absence de mobilisation générale pour la guerre a contraint les ressources disponibles, notamment en termes d’effectifs militaires, tandis que le fait d’inscrire le conflit dans un enjeu vital pour la sécurité des Etats-Unis a rendu plus difficile l’option du désengagement.
Critique de la stratégie post Saddam Hussein : La première et la plus immédiate des questions à laquelle il a fallu répondre dès le début concernait la conduite à tenir une fois Saddam Hussein renversé. L’interrogation a ainsi précédé le déclenchement des opérations militaires. Dans un rapport déclassifié concernant une simulation sur la gestion de l’Irak post-conflit, en date de 1999, le général des Marines Anthony Zinni, alors commandant du Central Command (CENTCOM), prévenait contre la dangerosité de ne pas réfléchir plus avant sur cette phase. Il soulignait notamment que « même si l’ordre public est restauré, les frontières sécurisées, le changement de régime serait problématique, spécialement si le nouveau régime est perçu comme faible ou comme une marionnette [entre les mains des Américains] »[3].
Le 26 février 2003, le président Bush déclarait : « les Etats-Unis n’ont pas l’intention de déterminer la forme précise du gouvernement du nouvel Irak. Ce choix relève des citoyens irakiens. Cependant, nous nous assurerons qu’un dictateur brutal ne sera pas remplacé par un autre. […] Reconstruire l’Irak nécessitera une implication longue de nombreuses nations, y compris la nôtre : nous resterons en Irak le temps nécessaire, mais pas un jour de plus »[4]. Enfin, le 28 février 2003, le Defense Policy Board, organisme d’aide à la décision interne au Département de la Défense, avertissait le pouvoir exécutif que le défi le plus urgent serait la création d’une sécurité durable en Irak. Robert Perito, auteur du mémorandum et membre de l’United Institute of Peace, recommanda notamment de créer une force de stabilisation civile, composée de policiers, de juristes et d’administrateurs.
Cependant, en dépit de ces recommandations, le Département de la Défense ne se dotera pas des moyens suffisants. Le ton de l’opération militaire contre Saddam Hussein est donné : une opération expéditionnaire courte, menée avec des moyens de haute technologie et associant des groupes paramilitaires locaux. Le modèle de l’invasion de l’Afghanistan qui avait mis au point un contingent de Forces Spéciales encadrant les unités de l’Alliance du Nord anti-Taliban et appuyées par des frappes aériennes ciblées, était ainsi pris en exemple. En dépit d’avertissements quant à l’issue du conflit et la nécessité de trouver une stratégie adaptée, l’administration resta dominée par l’idée selon laquelle la reconstruction de l’Irak ne nécessiterait qu’un engagement limité et qu’elle serait essentiellement le fait des Irakiens eux-mêmes.
Du côté militaire : une stratégie de stabilisation éludée
La doctrine officielle reste relativement indéterminée quant à la définition précise des missions et des moyens. Les décideurs militaires portent peu d’intérêt à ce type de missions. Les opérations de stabilisation sont ainsi reléguées hors de la guerre (operations other than war ou OOTW) et sont moins priorisées que les missions de combat (major combat operations ou MCO). Plus généralement, les élites militaires considèrent toute intervention longue et toute mission de Nation-Building comme posant le risque potentiel d’un enlisement. Ce refus de l’interventionnisme s’explique autant par un repli identitaire sur le modèle du pragmatisme radical que par le souci d’éviter un nouveau Vietnam.
Les décideurs militaires refusent l’idée d’un prolongement de leur présence en Irak. Le 7 avril 2003, le général Michael Hagee, Commandant du Corps des Marines déclare ainsi : « Ce que je voudrais suggérer, c’est que nous ne sommes ici que pour une courte période. Selon moi, nous avons besoin de refaire le plein, nous avons besoin de reconstituer nos forces maritimes pré-positionnées et nous avons besoin de consolider le Corps des Marines pour nous assurer qu’il est prêt à aller où on aura besoin de lui. Nous sommes une force expéditionnaire. Notre travail n’est pas ici, au Sud de l’Irak, où tout est terminé »[5]. Ce sentiment est partagé par le général Sanchez qui énonce dans le plan d’opération officiel rédigé en date de juillet 2003 que la mission consiste à « Conduire des opérations offensives pour défaire les forces réticentes et neutraliser les influences déstabilisatrices dans les zones d’opération afin de créer un environnement sécurisé en soutien de l’action de l’Autorité Provisoire de la Coalition. Dans le même temps, mener des opérations de stabilisation pour soutenir la création d’un gouvernement et le développement économique afin de mettre en place les conditions d’un transfert aux autorités civiles ou militaires désignées pour prendre la suite »[6].
L’urgence opérationnelle voire expéditive voulue par les élites politiques et militaires est manifeste : une fois Saddam Hussein renversé, la stabilisation doit aller très vite. Toutefois le manque de ressources nécessaires pour mener les missions de stabilisation conduit à une impréparation organique des unités déployées en Irak. Celles-ci doivent s’adapter rapidement. La stabilisation est ainsi davantage un projet et un slogan qu’une mission conceptualisée et mise en oeuvre de manière raisonnée.
L’Irak : un enjeu dans les relations politico-militaires
La décision d’envahir l’Irak et les échecs conséquents à le stabiliser ont considérablement creusé le fossé civilo-militaire. Ce fossé concerne essentiellement la place et l’autonomie de la sphère militaire. Le mandat du secréataire à la Défense Donald Rumsfeld (2003-2006) se traduit par une intrusion de la sphère politique au sein de la sphère militaire à travers un contrôle étroit des institutions. A contrario, la période post-2006 montre une tentative des militaires de reprendre leur autonomie et de peser davantage dans les décisions stratégiques.
Selon l’historien Michael Desch, « le bourbier irakien a simplement révélé une fracture qui existe depuis des décennies » entre les officiers et les décideurs politiques[7]. Il prend en exemple le précédent de la guerre du Vietnam, précisant qu’une grande partie des officiers a attribué l’échec du Vietnam à la micro-gestion de la guerre par le Secrétaire McNamara et les présidents Lyndon Johnson et Richard Nixon.
L’élection de George W. Bush n’apporte pas l’apaisement espéré. Le programme de « Transformation » du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld s’accompagne d’une réaffirmation du pouvoir civil sur les institutions militaires. Le général Eric Shinseki, chef d’Etat-major de l’Army à l’époque, conscient de l’insuffisance des moyens octroyés par le pouvoir politique, affirme au Congrès que les Etats-Unis auraient besoin de « plusieurs centaines de milliers de soldats » pour les opérations post-conflit, en lieu et place du dispositif plus léger imposé par Donald Rumsfeld au général Tommy Franks, Commandant le CENTCOM.
Dans ce contexte, la « contre-insurrection » apporte un élément supplémentaire. En effet, la doctrine présuppose que si les organisations civiles sont au coeur du processus de reconstruction et de stabilisation, les militaires sont de facto en charge de ces missions. De plus, les actions menées par les militaires peuvent produire des effets politiques déconnectés des objectifs stratégiques. Puisqu’il ne s’agit pas seulement de détruire un ennemi, mais de contrôler une population et d’assurer un rôle politique, les opérations de « contre-insurrection » semblent élargir la sphère de compétences des militaires.
La réponse à une stratégie inadaptée : l’adaptation tactique
L’action des militaires américains en Irak est étroitement dépendante du processus d’adaptation tactique qui eut lieu entre 2003 et 2008. Cette dynamique, propre au terrain, est intrinsèque aux unités déployées. Cela signifie qu’il s’agit d’un phénomène distinct de l’innovation doctrinale.
La littérature académique concernant l’innovation au sein des institutions militaires considère en effet que la doctrine canalise les adaptations tactiques et que les organisations fortement hiérarchisées adoptent un processus descendant (top down). Il existe un courant académique insistant sur le processus inverse, à savoir que les institutions militaires « apprennent » au contact d’un contexte opérationnel nouveau à partir des adaptations tactiques, lesquelles permettent l’adoption de nouvelles doctrines et de nouvelles structures de force. Lorsque les pressions externes (contexte opérationnel et demande politique), les facteurs institutionnels (culture organisationnelle, intérêts bureaucratiques, rivalités internes) et ce processus d’apprentissage convergent, ils permettent l’émergence de réformes qui peuvent aller de simples évolutions à de véritables révolutions. Selon les auteurs partisans de ce courant, la formulation d’une doctrine est donc l’aboutissement d’un processus ascendant (bottom-up) qui résulte des retours d’expériences.
Le cas irakien présente ceci de particulier qu’il échappe aux logiques top down ou bottomup. Aucune « descente », aucune directive efficiente du politique vers le militaire, ni aucune remontée une fois l’adaptation adoptée par les unités sur le terrain. En effet, l’adoption puis la publication de la nouvelle doctrine de contre-insurrection (communément désignée par sous l’appellation anglaise de surge), si elle répond bien aux pressions et à la demande politique, n’est pas directement liée à la stratégie adoptée à partir de 2007. De plus, la plupart des procédures tactiques sur le théâtre d’opération précèdent le surge. Il faut également noter que les adaptations tactiques n’ont pas donné naissance à de profondes réformes au sein des institutions militaires. Certes, on peut postuler que l’expérience combattante ainsi acquise ne sera pas perdue par les principaux acteurs en présence. En revanche, elle n’est pas institutionnalisée de manière durable dans les organisations.
Les innovations adoptées par les unités américaines sont organiques et fonctionnelles. Du fait de l’inadaptation à l’environnement, qui s’explique par l’absence de corpus de pratiques antérieur à l’invasion et l’impréparation des unités aux défis opérationnels post- conflit, les unités durent adopter des solutions pragmatiques. Il s’agit donc bien d’une « adaptation sous le feu » plutôt qu’un processus hiérarchisé.
Les unités déployées en Irak pour l’invasion s’étaient préparées à des opérations militaires courtes et visant à détruire l’armée irakienne. Dès lors, ni leurs procédures ni leur structure organique ne les préparèrent à gérer le chaos qui découla de la chute du régime et de la dissolution des forces de sécurité. Ce fait fut aggravé par la montée en puissance de l’insurrection à partir de l’été 2003. Par conséquent, en dépit de l’adoption d’une nouvelle doctrine, le surge, (phase IV), certains se considéraient encore en état de guerre, tandis que d’autres adaptaient leur matériel et leurs tactiques aux missions de contrôle de zone, voire d’administration.
Dès la chute du régime, les unités de la première division de Marines s’organisèrent pour les missions de soutien humanitaire qu’elles perçurent comme centrales dans la phase IV. Ainsi, un régiment d’artillerie se transforma-t-il en Civil Military Operations Center en plein coeur de Bagdad. La plupart des unités s’installèrent dans les villes et adoptèrent des procédures de patrouille, aussi appelées « missions de présence ». Il s’agissait de pallier le manque d’effectif par une dispersion des unités qui permettait d’occuper davantage de terrain et de se rendre visible, à défaut de pouvoir exercer un contrôle effectif.
Le manque de ressources allouées à la préparation d’un plan post Saddam Hussein eut des conséquences inattendues. Cela a forcé les unités aux échelons tactiques à prendre en compte l’administration de leur zone. De fait donc, les commandants de division se sont vus confier non seulement les questions de sécurité (police et interposition entre les factions) mais aussi les tâches liées à l’aide humanitaire et celles consistant à recréer au plus vite une administration fiable (élections de conseils municipaux et désignations de responsables communautaires). Sans mise en condition préalable à leur projection dans ces domaines DIME (Diplomatie, Information, action Militaire et Economie) et manquant de moyens organiques et d’effectifs pour mener à bien ces tâches concurremment aux actions de contrôle de zone (garde des points sensibles, points de contrôle, etc.), les officiers durent faire preuve d’adaptation durant l’été 2003. Certaines unités se restructurèrent par la création de structures ad hoc coordonnant l’action civilo-militaire, l’action psychologique, les problèmes de gouvernance et les tâches humanitaires. Très vite d’ailleurs, et contrairement à une opinion souvent répandue, les unités américaines ont restreint leurs opérations de force au profit des autres domaines. À partir de l’été 2003, la décision d’utiliser les fonds confisqués aux dignitaires du régime permit de régler la question des moyens. Mais le déclenchement d’attentats visant les infrastructures et les civils recrutés par les Américains a freiné ces efforts.
Dans le cadre de la lutte contre la guérilla, certaines unités américaines ont adopté des procédures de type policier (quadrillage, collecte du renseignement, arrestation, etc.). Du fait de leur présence au coeur des quartiers, les officiers américains mirent en place des systèmes de recensement. Ces recensements concernaient aussi bien les individus, les lieux clés des zones d’opérations que les véhicules entrant et sortant d’un quartier. La cartographie des quartiers et des réseaux sociaux ou politiques servit de base aux arrestations. Celles-ci furent menées de nuit sous la forme de raids conjointement avec les forces spéciales si celles-ci étaient disponibles.
Il fallut enfin s’adapter à la nécessité d’encadrer et former les forces de sécurité irakiennes. Initialement en effet, cet effort devait être coordonné par l’Autorité Provisoire de la Coalition. Cependant, le manque de ressources à la disposition des deux structures créées par Paul Bremer, directeur de la reconstruction et de l’assistance humanitaire en Irak, (le Coalition Military Assistance Training Team et le Coalition Police Assistance Training Team), ainsi que le défaut de coordination avec les unités américaines en charge de la sécurité, incitèrent le général Sanchez à ordonner la formation d’un Corps de Défense Civile. Au départ, il s’agissait de former un bataillon par commandement régional, puis un pour chacune des dix-huit provinces irakiennes, et enfin l’objectif est ajusté à 60 bataillons à la fin de l’année 2004. À cette date, le Corps de Défense Civile fut renommé Garde Nationale Irakienne.
Néanmoins, un basculement rapide s’opèra au sein des unités par l’intégration de certains de leurs membres au sein des forces irakiennes (les MiTT pour Military Transition Teams). Ce système de conseillers militaires permit ainsi d’encadrer les nouvelles unités irakiennes, tout en formant les officiers et sous-officiers.
Dès 2003, des unités et leurs chefs mirent en oeuvre des tactiques originales pour s’adapter au contexte local.
Le bilan de ces expériences montre que l’adaptation, bien qu’éclatée, fut effective et rapide. Deux types d’adaptation sont ainsi observables. L’adpation passe d’abord par l’ajout de capacités organiques en matière de renseignement, de procédures policières et de formation des forces de sécurité locales. Elle passe ensuite par la reproduction de standards bureaucratiques. Ce processus d’adaptation fut progressif et véritablement entériné au fur et à mesure que les unités comprenaient davantage le contexte opérationnel et capitalisaient sur les expériences précédentes.
Ce processus d’adaptation a été rendu possible par la conjonction de plusieurs facteurs : le partage d’expérience, la pression du contexte et l’absence de contraintes externes. Sur ce dernier point, en l’absence de doctrine, de freins organisationnels et de buts politiques précis, les officiers américains ont pu envisager un éventail d’options plus important.
De l’occupation à la stabilisation
L’action des militaires américains en Irak s’inscrit dans un ensemble complexe de tactiques et de stratégies. Restituer et analyser celles-ci nécessite d’en saisir la logique. En effet, l’analyse stratégique classique présuppose qu’il existe une transitivité entre les buts politiques, la définition de la stratégie et la mise en oeuvre tactique. Or, dans le cas irakien, les décideurs civils ont fait pression sur les institutions militaires afin de s’adapter au contexte de la stabilisation et d’adopter des ajustements tactiques. Dans le même temps, les buts de guerre sont restés imprécis car trop ambitieux. La stratégie a donc reposé essentiellement sur les commandants de théâtre. Ces derniers ont du définir leurs propres objectifs, certes liés aux fins proclamées à Washington, mais davantage conditionnés par leur propre perception du contexte sécuritaire et politique en Irak. En dépit des relations hiérarchiques établies entre le théâtre, le CENTCOM, le secrétaire à la Défense et le président, les commandants successifs de la Force Multinationale-Irak ont été les acteurs les plus influents pour déterminer la posture américaine en Irak.
À partir de 2006, la reprise en main du processus de définition stratégique par Washington a permis d’abaisser les objectifs politiques, autorisant le général Petraeus[8] à développer une stratégie plus cohérente car moins ambitieuse. La pression exercée par les demandes politiques a pesé sur les choix des commandants de théâtre qui se sont ajustés aux discours successifs de déni, d’escalade ponctuelle et décisive, et enfin de retrait.
La stratégie initiale : La présence militaire américaine en Irak répond à l’objectif du changement de régime dans le cadre d’une guerre dont le but officiel est de prévenir l’usage d’Armes de Destruction Massive (ADM) par Saddam Hussein. Le volet militaire de l’occupation obéit donc à une logique courtermiste : une fois le régime renversé, les troupes doivent fournir du soutien aux opérations humanitaires et de reconstruction avant un retrait prévu pour le mois de septembre 2003.
Le changement de stratégie : le surge : La reprise de l’initiative correspond à une redéfinition des objectifs militaires et politiques en Irak. La révision stratégique de 2006 est un long processus. Débuté à la mi-juin 2006, il aboutit en janvier de l’année suivante. Ce long délai s’explique par la difficulté à trouver un consensus et illustre dans le même temps la volonté des décideurs politiques de reprendre en main la décision stratégique. La nouvelle stratégie annoncée en janvier apporte en réalité peu de changements quant aux objectifs politiques, il s’agit toujours de retirer les troupes après avoir restaurer un État irakien souverain. Les principales modifications concernent les objectifs à atteindre en Irak et l’approche tactique. S’agissant des objectifs, l’effet recherché est clair, il s’agit d’aider le gouvernement irakien à rompre le cycle de la violence afin de hâter le retour des soldats. La stratégie se positionne donc en continuité avec l’approche précédente, à savoir le soutien au gouvernement irakien, mais précise que l’objectif est désormais la sécurité, et non l’élimination de l’insurrection.
Le surge est donc pluridimensionnel. Il désigne d’abord la décision politique prise par le Président Bush. Il s’agit de la volonté d’escalade en lieu et place d’un retrait progressif. Il se caractérise par une intensification des opérations militaires et par une reprise de l’initiative stratégique.
L’échec de la stabilisation : La stabilisation est ici entendue comme une stratégie visant à figer une situation sécuritaire à travers un monopole temporaire des moyens de coercition au profit de l’intervenant. Le problème majeur est qu’elle empêche simultanément la constitution d’un monopole par un acteur local ainsi que l’établissement d’un accord politique durable entre les belligérants. Le choix d’une stratégie de stabilisation par les Américains s’explique par des facteurs internationaux, à savoir le refus d’une occupation militaire de longue durée, assimilée à la colonisation, comme par des facteurs internes, à savoir le déclin du soutien populaire à l’intervention et la prise de conscience populaire de la nécessité d’un retrait.
La stabilisation, bien qu’abondamment critiquée, n’est pas une mauvaise stratégie en elle-même. C’est une stratégie parmi d’autres, louable et même appropriée pour résoudre provisoirement les difficultés politiques et sécuritaires. Mais elle ne permet pas d’atteindre des objectifs politiques, à savoir la constitution d’un État stable, pleinement démocratique et allié aux Etats-Unis. Considérant selon la formule weberienne que l’État est le seul à même de détenir et d’exercer le monopole de la contrainte légitime, la stratégie choisie n’a pas abouti à consolider le monopole des moyens de coercition et de leur usage légitime par le gouvernement irakien. Elle a même contredit ce processus de consolidation de l’État, dans la mesure où les militaires américains n’ont pas été capables de transférer leur statut d’utilisateurs crédibles, voire légitimes, de la force au pouvoir central et qu’ils ont laissé subsister des acteurs capables de défier les prétentions du pouvoir central.
References
Par : Cécile BONODOT
Source : Ecole de Guerre