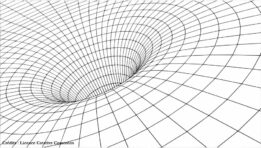Avec cet article, l’auteur propose une large mise en perspective historique du concept d’armée européenne. Son analyse s’enracine dans les premières années de l’après-guerre, avec la naissance d’une idée dont la concrétisation se heurte rapidement à de nombreux obstacles, et décrit la tentative actuelle de relance d’une armée européenne. L’article souligne également et surtout les problèmes structurels, au-delà du cours des évènements, et en particulier le rôle éminent du Politique et de la politique.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont : « L’Armée européenne : une gageure historique et structurelle » par George-Henri Soutou, RDN n°819, d’avril 2019
Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être visionnés sur le site de la RDN.
Les tensions en Ukraine, les crises en Afrique et au Moyen-Orient, l’évolution de la politique américaine reposent de façon aiguë la question de la sécurité et de la défense de l’Europe. Le président Emmanuel Macron a fait en juin 2017 d’importantes propositions. En fait, le sujet hante l’Europe depuis le Coup de Prague en 1948. Cependant, il faut distinguer trois choses : la défense de l’Europe, qui est actuellement assurée d’abord par l’Alliance atlantique, l’Europe de la défense, qui est un chantier en cours, et l’Armée européenne, notion qui va beaucoup plus loin, mais qui est avant tout un slogan, à la réalisation fort incertaine.
Une histoire peu encourageante
Au début de la guerre froide, la question d’une défense européenne de l’Europe était, on l’a oublié, très présente. Ce fut, en premier lieu, le Pacte de Bruxelles de mars 1948, une alliance militaire qui rassemblait la Grande-Bretagne, la France et les trois pays du Benelux face à la menace soviétique et qui disposait d’un état major permanent, destiné à assurer le commandement des forces des pays de l’UEO en cas de guerre (Antonio Varsori : Il Patto di Bruxelles (1948): tra integrazione europea e alleanza atlantica ; Bonacci Editore, Roma, 1988). En second lieu, l’aggravation de la tension Est-Ouest, avec la guerre de Corée en juin 1950, poussa les pays européens à se fondre dans l’Otan, la structure militaire du Pacte atlantique signé en avril 1949 : tout le monde était d’accord pour penser que les États-Unis et l’Otan constituaient à l’époque la seule garantie de sécurité valable face à l’URSS (Maurice Vaïsse, Pierre Mélandri et Frédéric Bozo (dir.) : La France et l’Otan 1949-1996 ; Complexe, 1996). On passait à la défense atlantique de l’Europe. Seulement cette dépendance militaire envers l’Amérique a persisté jusqu’à nos jours, malgré la fin de la guerre froide.
Une Armée européenne, ou Communauté européenne de défense (CED), fut certes envisagée en 1950, mais il s’agissait alors beaucoup plus de trouver un cadre acceptable pour le réarmement allemand que d’une véritable défense européenne : les unités européennes, si la CED avait vu effectivement le jour, auraient été placées sous commandement Otan ; on ne prévoyait ni état-major ni commandement européen. De toute façon le projet, d’ailleurs très complexe dans son organisation, finit par échouer devant l’Assemblée nationale française le 30 août 1954 (Michel Dumoulin (dir.) : La Communauté européenne de défense, leçons pour demain ? ; Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes / Peter Lang, coll. « Euroclio. Études et documents » (n° 15), 2000, 588 p.).
L’idée cependant d’une « défense européenne » à côté de l’Alliance atlantique (mais sans l’intégration et la supranationalité prévues par la CED) ne disparut pas. Seulement, on passa de la « méthode communautaire » à la méthode multilatérale, et même bilatérale. La défense européenne était bien présente dans l’esprit du général de Gaulle quand il conclut avec la RFA en janvier 1963 le traité de l’Élysée : celui-ci était bilatéral, mais il était aussi une pierre d’attente pour reprendre le projet d’Union politique à Six (couramment appelé « Plan Fouchet ») que nos partenaires avaient finalement repoussé en 1961. Rappelons ce que le Général avait dit à la Führungsakademie de Hambourg le 7 septembre 1962 : « La coopération organique de nos armées en vue d’une seule et même défense est donc essentielle à l’union de nos deux pays. »
Et le traité de l’Élysée prévoyait, outre les réunions régulières des principaux responsables et des chefs d’état-major, une coopération étendue en matière de politique extérieure, « en vue de parvenir, autant que possible, à une position analogue » sur tous les problèmes d’intérêt commun. De plus, part le traité de l’Élysée comportait en matière de défense un volet important. Le préambule constatait « la solidarité qui unit les deux peuples… au point de vue de leur sécurité… ». L’objectif était ambitieux ; outre des échanges de personnel et un travail en commun en matière d’armements dès le stade d’élaboration des projets, il prévoyait que : « Sur le plan de la stratégie et de la structure, les autorités compétentes des deux pays s’attacheront à rapprocher leurs doctrines en vue d’aboutir à des conceptions communes. Des instituts franco-allemands de recherche opérationnelle seront créés. »
Tout cela allait loin, et nous verrons dans les pages qui suivent qu’Emmanuel Macron a repris ces objectifs, qui sont sans doute les plus pertinents aujourd’hui. Mais tout cela était d’abord politique, et reposait sur un accord géopolitique fondamental entre de Gaulle et le chancelier Adenauer : la crise de Cuba à l’automne précédent avait prouvé la nécessité pour les Européens de reprendre en mains leur sécurité car, en cas de crise, les Américains penseraient d’abord à eux.
Mais le Bundestag ne partageait pas l’analyse du chancelier Adenauer et fit précéder le traité, lors du débat de ratification, d’un préambule qui réaffirmait le rôle primordial de l’Alliance atlantique. Une majorité de responsables allemands n’avaient nulle envie d’être les brillants seconds de Paris. Et finalement le volet stratégique du traité de l’Élysée devait végéter, malgré sa pertinence stratégique, pour des raisons politiques (Georges-Henri Soutou : L’Alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996 ; Fayard, 1996).
La fin de la guerre froide a cependant relancé la notion de défense européenne, avec les traités de Maastricht (1992) et de Lisbonne (2007) qui ont posé le principe d’une Politique européenne de sécurité et de défense. Toute une série de décisions furent prises à partir du Sommet franco-britannique de Saint-Malo en 1998, qui marqua l’entente des deux puissances militaires les plus conséquentes et actives de l’Union européenne. Au Sommet d’Helsinki en décembre 1999 les membres de l’UE décidèrent de créer un comité militaire regroupant les ministres de la Défense des différents pays, un comité politique réunissant les ministres des Affaires étrangères, un état-major militaire de planification (mais pas de commandement, pour ne pas concurrencer l’Otan) qui serait le conseiller militaire du Conseil européen. On décida, en outre, que dès 2003 l’Union devrait être capable de projeter, éventuellement hors de son territoire et pendant six mois, une « force de réaction rapide » de 60 000 hommes (on en est loin…). On créa également en 2004 une « agence européenne de défense », afin de dégager et de conduire des programmes d’armements communs.
En 2004, on mit au point un dispositif pour d’éventuelles opérations menées en dehors de l’Otan, le commandement effectif étant assuré par le pays européen le plus engagé dans cette opération. Il y eut des opérations strictement européennes en Afrique sur ce modèle (par exemple au Congo ex-Zaïre), ou encore l’opération Atalante, contre la piraterie au large de la Somalie.
Bien entendu, cette notion de défense européenne était comprise désormais non plus dans le contexte de la guerre froide, mais dans une stratégie axant la sécurité de l’Europe sur la prévention des crises à sa périphérie (à la suite de l’expérience cuisante des Balkans) : opérations de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix (« missions de Petersberg ») ; éventuellement opérations militaires extérieures d’ingérence humanitaire, dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (« menace contre la paix ») et dans un ensemble multilatéral (ONU ou Otan).
Mais cet argumentaire, qui ne niait pas le concept d’Europe de la défense, même s’il l’interprétait de façon très prudente, a été rendu moins convaincant à la suite de l’intervention en Libye, en 2011 : on sait que l’Union européenne a été profondément divisée, les Britanniques et les Français menant l’opération, la RFA refusant absolument d’y participer (Thierry de Montbrial et Georges-Henri Soutou (dir.) : La défense de l’Europe entre Alliance atlantique et Europe de la défense ; Hermann, 2015).
La tentative actuelle de relance
Devant le Bundestag, le président de la République a récemment proclamé la nécessité de créer une « Armée européenne », expression qui va beaucoup plus loin que les formules plus fréquentes de « défense européenne » ou de « politique européenne de sécurité et de défense ». Car là il ne s’agirait plus de simplement coordonner, mais d’« intégrer » et même d’unifier. Mme Merkel a repris l’expression devant le Parlement européen. Cela nous ramène aux années 1950.
Mais en fait nous sommes plutôt en train de rejouer la même séquence qu’en 1961-1963. En septembre et octobre 2017, Paris a fait une série de propositions pour relancer la « Politique de sécurité et de défense commune » évoquée par le traité de Lisbonne : établissement d’une « Coopération structurée permanente » entre pays volontaires ; création d’un Fonds européen de défense ; « Initiative européenne d’intervention » pour les opérations extérieures ; et appel à une « culture stratégique partagée », par des échanges d’officiers dans les états-majors et les Écoles de Guerre, ce qui rappellera au lecteur ce qui fut décidé en 1963. Mais Berlin n’a pas accepté la création d’un « Quartier général européen commun », annoncé dans le programme électoral d’Emmanuel Macron. Ce point ne fut donc pas finalement repris dans le discours du président de la République à la Sorbonne le 26 septembre 2017. Or, il est essentiel : l’UE ne dispose que d’un petit état-major de planification, les opérations importantes relèvent toujours des états-majors de l’Otan ; en outre les accords de 1996 qui devraient permettre à l’Otan de mettre des moyens à disposition de l’Union européenne ont toujours été bloqués par la Turquie.
Certes, Paris et Berlin sont d’accord pour penser que la résurgence de la Russie et les incertitudes comme la brutalité américaines doivent pousser les Européens à s’unir davantage en matière de défense (Cf. l’interview de Heiko Maas dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 8 septembre 2018). Mais l’accord s’arrête là : la coopération structurée (Pesco) a été signée en novembre 2017 par 23 pays sur 28, beaucoup plus que ne le souhaitait Paris, qui voulait un petit groupe très structuré pour des opérations « dures », alors que Berlin préférait un grand ensemble souple pour des opérations plus modestes. Avec un souci qui se comprend : ne pas paraître, aux yeux des autres partenaires, vouloir tout régenter à partir de Paris et Berlin. Mais ainsi conçue, et sans quartier général commun, l’« armée européenne » n’aurait aucune substance.
Les problèmes structurels
Mais au-delà du cours des événements, il faut voir les problèmes structurels.
• Les rapports entre la défense européenne – ou la personnalité européenne de défense – et l’Alliance atlantique. Cette question est tout à fait fondamentale. Mais elle est bloquée : une défense européenne en dehors de l’Otan n’est pas pour le moment envisageable, on n’en a ni la volonté, ni les moyens. Une politique de défense européenne au sein de l’Otan est régulièrement évoquée, en particulier depuis 1996, mais les Américains et la plupart des membres de l’Alliance, n’en veulent pas. Ou, en tout cas, Washington la limite étroitement : il faut éviter toute duplication entre les moyens européens et ceux de l’Otan. De toute façon, les États-Unis restent les seuls à posséder certaines capacités essentielles (techniques de communication et d’observation de haute technologie, transport aérien stratégique, etc.). Et malgré les incertitudes américaines actuelles, beaucoup de pays de l’UE préfèrent encore dépendre de Washington que d’un quelconque couple franco-allemand.
• Le problème de la Grande-Bretagne, la seule avec la France à avoir encore des capacités réelles. Depuis les accords de Lancaster House en 2010, on a cru à l’émergence d’un couple stratégique franco-britannique remplaçant le couple franco-allemand défaillant. Mais il est clair que le Brexit et ses conséquences encore imprévisibles remettent en cause cette orientation.
• Le retrait progressif de l’Allemagne, qui avait accepté de participer aux opérations au Kosovo en 1999, qui avait exprimé cette année-là de l’intérêt pour la conception française d’une « Europe-puissance » plus indépendante, qui s’était engagée avec l’Otan en Afghanistan à partir de 2001, mais qui a refusé de participer à l’affaire libyenne en 2011. Bien entendu, la coopération franco-allemande est absolument indispensable. Et le problème récurrent des rapports du couple franco-allemand avec les États-Unis (oscillant entre une rivalité à qui bénéficiera des bonnes grâces de l’Amérique, ou la nécessité pour la RFA d’un choix impossible entre Paris et Washington…) a à peu près disparu depuis le retour de la France dans le commandement intégré de l’Otan, et encore plus depuis l’arrivée au pouvoir du président Trump.
Restent deux différences importantes entre les deux pays. Tout d’abord une divergence au sujet de la conception même de la puissance. La RFA accorde plus d’importance aux institutions multilatérales, et au Soft Power sous toutes ses formes (l’influence, la persuasion, la négociation, les normes, les sanctions) que Paris, qui a une vision plus traditionnelle de la puissance militaire, encore que la différence me paraisse se réduire actuellement (Cf. le discours prononcé le 9 septembre 2011 par Mme Merkel devant le Bergedorfer Gesprächskreis, Deutschland, Europa und Asien in einer neuen Weltordnung, Bergedorfer Gesprächskreis, Körber-Stiftung, Hambourg 2012. Le diplomate français Pierre Buhler, dans son livre La puissance au XXIe siècle (Fayard, 2011) n’est pas loin de cette conception : « la puissance est diffuse et multiforme »). Le Livre blanc allemand de 2016 marque une inflexion par rapport au précédent dans un sens plus ferme, et le budget fédéral de la défense est en nette augmentation depuis trois ans.
Mais à côté de cette divergence d’ordre général sur le vaste problème de ce que peut signifier et comporter la puissance au XXIe siècle, et même si cette divergence tend à se réduire, on note un motif de division précis et grave : la RFA veut le retrait à terme des armes nucléaires d’Europe, ce qui concerne donc les États- Unis mais aussi, éventuellement, la France.
Ajoutons de façon générale que Berlin ne veut pas entrer dans le jeu français permanent, dont elle comprend bien les arrière-pensées (continuer à jouer un rôle dans le « couple » grâce à la puissance, alors que sur le plan économique nous sommes distancés, et ainsi transposer au niveau européen la vision – et les intérêts – français).
C’est sans doute de cette manière qu’il faut interpréter la suggestion du vice-chancelier Olaf Scholz le 18 novembre dernier d’attribuer le siège de la France au Conseil de sécurité à l’Union européenne (idée d’ailleurs pas vraiment nouvelle à Berlin) (Le Monde, 30 novembre 2018). Cette déclaration en a énervé beaucoup à Paris, mais, outre que si l’Europe devenait une véritable fédération la question se poserait de toute évidence, c’est surtout une façon de mettre les Français en face de leurs discours sur l’Europe, qui peuvent agacer nos partenaires…
À mon avis, la RFA pourrait se rallier désormais à un agenda européen de puissance, à condition que la relation franco-allemande soit modifiée en profondeur. À condition de mettre à plat les arrière-pensées de part et d’autre, et peut-être aussi de comprendre que Berlin prendra au sérieux les invites françaises récurrentes appelant à l’Europe-puissance lorsque Paris acceptera de discuter sur le fond de certains sujets tabous, comme le rôle des armes nucléaires aujourd’hui ou la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.
Conclusion : politique d’abord…
Pour relancer les choses, puisque la « méthode communautaire » et la « méthode bilatérale » sont toutes deux en panne, qu’imaginer ? D’abord, bien entendu, faire fonctionner de façon pragmatique ce qui existe en matière de sécurité, de défense et d’industries d’armements, les nombreux dispositifs mis en place, au moins sur le papier, depuis 1999 au niveau de l’Union, depuis 1963 ou 1982 au niveau franco-allemand (Claudia Major : « La France, l’Allemagne et la défense européenne : pour plus de pragmatisme et moins de pathos », Cerfa, Ifri, janvier 2013).
Mais bien sûr à plus long terme cela ne suffira pas, si l’on veut, au-delà des questions techniques, aborder le problème fondamental d’une défense européenne de l’Europe. Or, sans même évoquer tous les problèmes que poserait une véritable armée commune (quel recrutement, quelle organisation, quel degré d’acceptation par les peuples ?), bien des problèmes politico-stratégiques non résolus se posent. Que faire de la dissuasion nucléaire française ? Peut-on raisonnablement la partager (et plus seulement laisser entendre qu’elle peut être « étendue » à nos voisins, comme il est dit depuis le Livre blanc de 1972) ? Et peut-être surtout : d’où vient la principale menace, de l’Est ou du Sud, sachant que Berlin est peu convaincu de la pertinence de notre politique militaire africaine ?
Ensuite, si l’Armée européenne devait faire partie des organismes de l’Union, elle relèverait de la juridiction de la Cour de justice européenne de Luxembourg, et l’Allemagne n’accepterait d’ailleurs pas, étant donné son évolution depuis les années 2000, qu’il en fût autrement. Cela compliquerait beaucoup la gestion d’éventuelles opérations extérieures.
En outre, il reste un point essentiel, ce sont les autres. Il est essentiel que les autres pays, en dehors de la France et de la RFA, trouvent le moyen de s’associer à la défense européenne. Ce qui a toujours été la position de Berlin, à juste titre. C’est l’avantage de la méthode communautaire par rapport à la méthode interétatique. Certes, il y aura toujours certaines opérations à longue portée qui seront menées par un groupe plus limité de pays. Mais la légitimité européenne pour une éventuelle défense commune suppose une participation de tous, et l’arrière pensée selon laquelle seuls les « Grands » comptent me paraît nocive. Pour le moment, la seule perspective réaliste serait d’exploiter au maximum les possibilités de « coopérations renforcées » ouvertes par le traité de Lisbonne. Ou encore la méthode allemande consistant à mettre sur pied des unités communes avec ses différents voisins, ce que nous pratiquons nous-mêmes, de façon plus limitée, avec les Britanniques et les Belges.
Cependant, à l’heure actuelle, force est de constater que les avancées les plus concrètes ont lieu dans le domaine des armements, avec des programmes multinationaux et la création d’un Fonds européen de défense qui va financer des recherches et des fabrications, et qui est doté d’un important budget (13 milliards d’euros). C’est certes indispensable, mais cela correspond à l’approche et à la méthode de la construction européenne depuis la Communauté charbon-acier en 1950 : la création de structures économiques et techniques communes est supposée conduire progressivement, pense-t-on depuis Jean Monnet, à l’émergence d’un sentiment d’appartenance et d’une volonté politique partagés.
Or, les armements ne peuvent jamais être compris en dehors de leur contexte politique, intérieur et extérieur, de leur environnement économique, social, voire culturel. L’illusion de l’ingénieur et du technocrate, sous-jacente aux orientations actuelles et selon laquelle les nouveaux moyens militaires conduiront forcément les acteurs à adopter de nouveaux concepts stratégiques et de nouvelles orientations politiques, est trop simple. Ne posons pas la question inactuelle d’une Fédération européenne. Il reste que, sans une volonté politique commune, sans des conceptions stratégiques communes, sans des organisations compatibles et des états-majors opérationnels communs, il n’y aura pas de défense européenne. Et même les programmes d’armements communs trouveront vite leurs limites dans la multiplication des versions « nationales » et les hésitations doctrinales. On en a eu de nombreux exemples par le passé…
Par : Georges-Henri SOUTOU
Source : Revue Défense Nationale