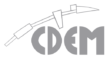Avec cette publication de veille, l’auteure éclaire un fait marquant de l’actualité récente, l’opération militaire lancée début 2018 dans le nord-ouest de la Syrie pour y déloger les combattants kurdes. Outre les faits saillants et le contexte général dans lequel l’opération s’est déroulée, elle pointe également l’enchevêtrement des enjeux et tensions externes entre la Turquie, l'OTAN et la Russie, mais également internes à la Turquie.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont : Elise Laville, « L’opération « Rameau d’olivier» en Syrie, reflet des ambitions de la Turquie d’Erdoğan », CDEM.
Ce texte, ainsi que d’autres publications peuvent être visionnés sur le site du CDEM :
L’opération « Rameau d’olivier » en Syrie,
reflet des ambitions de la Turquie d’Erdoğan
Faits
Le président Erdoğan présente cette offensive comme une opération antiterroriste visant à empêcher les YPG[1], considérés comme une extension du PKK[2], de contrôler une vaste bande de territoire à la frontière turque. Le premier objectif est le canton d’Afrin, situé à 20 km de la frontière. Entre 10 000 et 20 000 rebelles, regroupés sous la bannière de l’Armée syrienne libre (ASL), assistent les quelque 6 000 soldats turcs déployés pour l’offensive[3]. L’avancée des troupes au sol est appuyée par un engagement significatif de l’artillerie, des blindés et de l’aviation turque, notamment lors de la phase initiale de l’opération en zone montagneuse. 72 avions de combat (F-16 et F-4 2020s) sont mobilisés le premier jour de l’offensive[4] (soit 25 % du parc des forces aériennes turques)[5]. L’opération est rendue possible par le feu vert de Moscou, qui retire ses forces de police militaire présentes à Afrin un jour avant le lancement de l’offensive turque. La Russie aurait laissé le champ libre à Ankara après avoir échoué à convaincre les YPG de laisser les troupes pro-régime s’emparer d’Afrin[6].
Malgré la multiplication des annonces de victoire imminente, l’offensive piétine dès les premiers jours face à la résistance des 8 000 à 10 000 combattants kurdes positionnés dans le canton d’Afrin. Plusieurs sources avancent que les YPG disposeraient, entre autres, de missiles antichars guidés (9M113 Konkurs et 9M133 Kornet russes, BMG-71-TOW américains) et de MANPADs (man-portable air-defense system) SA-18 Igla russes[7]. Cet arsenal leur aurait notamment permis d’endommager, voire de détruire plusieurs dizaines de chars turcs[8], et d’abattre au moins un hélicoptère T129 ATAK[9]. Fin février, Ankara renforce ses effectifs en déployant 3 000 éléments des forces spéciales de la police et de la gendarmerie entraînées au combat urbain. Le 18 mars, au terme de 58 jours de combats, les milices kurdes décident de se retirer d’Afrin, annonçant poursuivre une campagne de guérilla dans les montagnes alentours. Près de 300 civils auraient perdu la vie lors des bombardements ; parmi les combattants, les pertes sont estimées à 1 500 côté kurde et 400 côté ASL/Turquie, tandis que plus de 200 000 personnes auraient fui la région pour échapper aux hostilités[10].
Damas n’a pas manqué de condamner l’intervention turque en territoire syrien, mais n’a autorisé qu’un maigre déploiement de quelques centaines de miliciens loyalistes en soutien aux Kurdes[11]. Du côté des partenaires occidentaux, les appels à la retenue se sont multipliés, les États-Unis reprochant à Ankara d’entraver la lutte contre Daech dans l’est de la Syrie : l’offensive turque a en effet détourné vers Afrin près de 1 700 miliciens kurdes membres des FDS[12]. Le président Erdoğan a en retour déploré le manque de soutien de l’OTAN[13], et annoncé vouloir poursuivre l’offensive en direction de Manbij, à une centaine de kilomètres à l’est d’Afrin, où sont stationnées les forces spéciales américaines et françaises ; il a également menacé d’intervenir dans le Sinjar, au nord-ouest de l’Irak[14]. Malgré son accord initial, Moscou s’est rallié à Téhéran pour demander à Ankara de se retirer d’Afrin au bénéfice des troupes pro-régime. M. Erdoğan leur a opposé une fin de non-recevoir, invoquant des impératifs sécuritaires justifiant un maintien de la présence turque. Ankara a ainsi soutenu la mise en place d’un conseil local composé de membres de l’opposition syrienne pour la gestion des affaires courantes d’Afrin[15], tandis que la police turque a pris en charge la formation de forces de sécurité.
Contexte
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte menée depuis 1984 contre le PKK, organisation considérée comme terroriste par Ankara[16]. Le conflit opposant le mouvement de guérilla séparatiste au gouvernement turc aurait déjà fait plus de 40 000 morts[17]. En 1999, l’arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan met temporairement fin à l’insurrection, qui reprend en 2004. Une nouvelle cessation des hostilités accompagne l’ouverture officielle de négociations de paix entre Ankara et le PKK, en 2013. Lors des élections parlementaires de juin 2015, l’AKP[18] d’Erdoğan réalise son plus mauvais score depuis 2002 (40 % des voix), face à la montée en puissance des nationalistes du MHP (16 %) et du parti kurde HDP (13 % des voix). Le gouvernement turc décide alors de changer de stratégie et de suspendre les négociations menées avec le PKK, afin de tenter de conquérir les électeurs nationalistes opposés au processus[19]. La rupture des pourparlers entraîne la reprise de lutte armée à l’été 2015 dans le sud-est de la Turquie[20].
À nouveau considérée comme un impératif sécuritaire immédiat, la lutte contre le PKK redevient un élément central dans la stratégie régionale de la Turquie. L’autonomie acquise par les Kurdes syriens dans le nord de la Syrie est perçue comme une menace. Ankara dénonce la formation d’un corridor terroriste le long de la frontière, servant de base arrière pour la planification d’attaques contre les forces de sécurité turques, revendiquées par le PKK et par l’organisation affiliée des Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK). La menace devient également djihadiste, avec une succession d’attentats attribués à Daech sur le sol turc en 2015[21]. La Turquie va alors changer de stratégie. En juillet 2015, après des mois de tractations, la coalition menée par les États-Unis reçoit l’autorisation d’utiliser la base d’Incirlik, dans le sud de la Turquie, afin de mener des frappes contre Daech en Syrie. En juin 2016, le président Erdoğan adresse des excuses à la Russie, mettant ainsi fin aux tensions liées à l’incident de novembre 2015, lorsqu’un bombardier russe SU-24 avait été abattu par l’aviation turque. Le canal de discussion avec Moscou, maître de l’espace aérien syrien, est à nouveau ouvert. Ankara négocie alors l’autorisation d’intervenir dans le nord du pays. En échange, des concessions auraient été faites sur le soutien de l’opposition à Alep, la chute de Bachar al Assad n’étant plus considérée comme prioritaire[22]. L’opération « Bouclier de l’Euphrate », lancée en août 2016, marque le tournant « anti-terroriste » opéré par la Turquie dans son approche du conflit syrien[23]. Aux côtés de l’ASL, l’armée turque s’empare de villes tenues par Daech, telles que Jarabulus, Azaz et al-Bab. Les gains territoriaux réalisés servent alors également à empêcher les YPG de relier les zones sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie et de réaliser leur projet de Rojava (Kurdistan syrien) autonome. À la suite de ces victoires, le président Erdoğan exprime déjà sa volonté de s’emparer de Manbij afin de repousser les milices kurdes à l’est de l’Euphrate, mais recule face à la détermination des États-Unis d’y maintenir des forces spéciales en soutien aux FDS[24]. En mars 2017, le gouvernement turc annonce la fin de l’opération, tout en précisant ne pas exclure le lancement d’une nouvelle campagne pour protéger ses frontières.
La Turquie et ses partenaires occidentaux ne partagent pas la même vision des YPG : pour eux, les milices kurdes syriennes constituent un allié de poids dans la lutte contre Daech. En 2012, le retrait des forces loyales à Damas permet au PYD de prendre le contrôle de plusieurs cantons dans le nord de la Syrie. En 2014, lors du siège de Kobané, et face à l’inaction d’Ankara, les milices kurdes reçoivent pour la première fois le soutien officiel de la coalition dirigée par les États-Unis. La victoire des YPG contre Daech en janvier 2015 conforte Washington dans sa stratégie de soutien aux Kurdes syriens. Les combattants kurdes, présents en nombre au sein des FDS, participent, au grand dam d’Ankara, à la libération de Raqqa en octobre 2017. En représailles au soutien apporté aux YPG, l’agence de presse Anadolu, proche du gouvernement turc, publie à deux reprises une carte dévoilant la position des forces spéciales françaises et américaines dans le nord de la Syrie[25]. En janvier 2018, la révélation du projet américain de création d’une force frontalière de 30 000 soldats, composée majoritairement d’éléments kurdes issus des FDS, aurait accéléré le déclenchement de l’offensive vers Afrin[26]. La coopération avec les YPG reste, malgré les protestations de la Turquie, incontournable pour Washington et Paris : outre leur participation à la poursuite de la lutte contre Daech, notamment dans la province de Deir-ez-Zor, les YPG détiennent de nombreux djihadistes occidentaux arrêtés en Syrie. Preuve de l’importance de cette alliance, les visées expansionnistes du président Erdoğan vers Manbij auraient été accueillies par un renforcement de la présence des forces spéciales américaines et françaises[27] sur place et par des livraisons supplémentaires d’armes lourdes aux FDS[28].
Depuis la tentative de coup d’État de 2016, les relations de la Turquie avec ses partenaires de l’OTAN se sont détériorées. Outre le soutien apporté aux combattants kurdes, plusieurs points de discorde ont émergé. Le président Erdoğan rappelle régulièrement que les États-Unis, où réside Fethullah Gülen, ancien allié désigné comme l’instigateur de la tentative de putsch, n’ont toujours pas répondu à la demande d’extradition formulée par Ankara. Autre point sensible : les purges qui ont suivi la tentative de coup d’État ont visé les éléments les plus atlantistes au sein de l’armée turque[29]. Plusieurs États européens, dont l’Allemagne, ont alors offert l’asile politique à des militaires turcs visés par le mouvement de répression. En représailles, Ankara a interdit à des parlementaires allemands de rendre visite aux soldats de la Bundeswehr stationnés sur la base d’Incirlik. En juin 2017, Berlin réplique en annonçant le transfert de ses soldats et de ses chasseurs Tornado en Jordanie. En janvier 2018, les autorités allemandes décident de suspendre la modernisation des chars Leopard turcs[30], en raison de leur utilisation contre des combattants kurdes lors de l’offensive vers Afrin. Cette modernisation avait été programmée par Rheinmetall à la suite des lacunes constatées lors de l’intervention turque contre Daech à al-Bab en 2017[31]. Face à ce revers, le gouvernement Erdoğan n’a pas manqué de jouer la carte nationaliste en utilisant « Rameau d’olivier » comme un outil de promotion des équipements réalisés par l’industrie de défense turque[32].
Enjeux
L’attitude ambiguë de la Turquie vis-à-vis de ses partenaires occidentaux, notamment la menace d’aller jusqu’à une confrontation directe avec ses partenaires de l’OTAN à Manbij, soulève des interrogations quant à sa fiabilité en tant que membre de l’Alliance. Les purges qui ont suivi la tentative de coup d’État de juillet 2016 ont contribué à accroître l’influence des cercles eurasiens, favorables à une réorientation de la Turquie vers l’est, au sein de l’armée et du gouvernement. Le soutien affiché par le Kremlin au président Erdoğan lors de cet événement a accéléré le rapprochement des deux pays. La Russie semble depuis tirer parti de la situation en encourageant les dissensions entre la Turquie et ses partenaires otaniens. Fin 2017, Ankara a ainsi confirmé l’acquisition de quatre batteries de défense aérienne russes S-400 Triumph, dont la livraison est prévue dès juillet 2019[33]. Incompatibles avec les dispositifs de l’OTAN, ces systèmes sont également susceptibles de menacer la supériorité aérienne des alliés occidentaux de la Turquie en Europe orientale[34]. En guise de sanction, le Congrès américain menace de suspendre la livraison de 100 avions de combat F35A; Ankara annonce en retour envisager l’acquisition de chasseurs russes Sukhoi Su-57[35]. L’introduction possible de nouvelles restrictions quant à l’utilisation de la base d’Incirlik pour les opérations aériennes contre Daech aurait également poussé les États-Unis à y réduire leur présence[36].
Le gouvernement turc reste cependant dépendant de ses alliés otaniens. Le président Erdoğan a, à plusieurs reprises, réaffirmé son intérêt pour un déploiement de missiles antiaériens Patriot américains le long de la frontière turco-syrienne. Initialement déployés en 2013 à la demande du gouvernement turc, inquiet face à la menace d’éventuels tirs de missiles du régime syrien, ils avaient été retirés en 2015 suite à un désaccord avec Washington[37]. Ankara a également confirmé sa volonté de coopérer avec le consortium franco-italien Eurosam sur le système antimissile SAMP/T[38]. En avril 2018, le président turc a déclaré soutenir les frappes menées en Syrie par Washington, Paris et Londres en réponse aux attaques chimiques attribuées au régime de Bachar al-Assad – tout en soulignant le fait que la base d’Incirlik n’avait pas été utilisée lors de l’opération. Le rapprochement avec Moscou ne remettrait ainsi pas en cause l’ancrage de la Turquie à l’OTAN. Il semble plutôt être instrumentalisé par Ankara, qui tente d’obtenir des garanties et des concessions de la part de ses alliés occidentaux. La probabilité d’une confrontation directe entre partenaires otaniens en Syrie paraît quasiment nulle, d’autant que le gouvernement turc a annoncé avoir trouvé un accord avec Washington au sujet de Manbij[39]. Inversement, la Turquie demeure un allié stratégique de par sa position géographique, notamment pour ses partenaires européens qui comptent sur le bon vouloir d’Ankara en matière de coopération dans la lutte contre la menace djihadiste et pour la gestion des flux de réfugiés[40].
Le réchauffement des liens avec Moscou a notamment permis à la Turquie d’être admise à la table des discussions sur l’avenir de la Syrie. En 2017, Ankara a été intégrée par la Russie dans le processus d’Astana, aux côtés de l’Iran, et participe depuis à l’établissement de zones de désescalade[41]. Si elle constitue une forme de reconnaissance de son rôle d’acteur sur le théâtre syrien, la participation de la Turquie aux négociations met surtout en lumière le rôle secondaire qui lui a été dévolu par la Russie[42]. Vladimir Poutine reste en effet le maître du jeu, et le fait régulièrement remarquer à son homologue turc. À plusieurs reprises, le président russe a rappelé sa volonté d’inclure des représentants kurdes dans les négociations. Il utilise la question kurde comme monnaie d’échange pour obtenir des concessions de la part d’Ankara, capable d’influencer certains groupes opposés au régime de Bachar al-Assad[43]. Une éventuelle poursuite de l’opération « Rameau d’olivier » est ainsi conditionnée par l’obtention du consentement russe. Des négociations seraient en cours au sujet de Tel Rifaat[44], située à une cinquantaine de kilomètres à l’est d’Afrin. Moscou, Téhéran et Damas souhaitent obtenir des concessions de poids en retour ; ils verraient d’un mauvais œil les visées d’Ankara sur la base aérienne de Menagh, localisée au nord de Tel Rifaat et susceptible de représenter un avantage stratégique sur le terrain[45].
Par ailleurs, en février 2018, le gouvernement turc annonce que 350 000 Syriens réfugiés en Turquie se réinstalleront à Afrin à l’issue de l’opération[46]. Des observateurs rapportent que 140 000 réfugiés syriens auraient déjà été relogés dans les zones passées sous contrôle turc après l’opération « Bouclier de l’Euphrate »[47]. Face à ce qui ressemble à une stratégie d’implantation durable dans le nord de la Syrie, certains analystes accusent la Turquie d’ambitions néocolonialistes et dénoncent une politique d’arabisation[48]. La création d’une zone tampon à la frontière syrienne répond certes à l’objectif d’éloignement de la menace terroriste. Accueillant plus de 3,5 millions de réfugiés syriens, Ankara semble cependant y voir l’opportunité de faire d’une pierre deux coups, en repeuplant la zone avec des populations supposées favorables à la Turquie, tout en réduisant les tensions liées à l’accueil de ces réfugiés sur le sol turc. Il reste à voir jusqu’à quel point cette stratégie d’« occupation » sera acceptée par Moscou et Damas[49].
L’opération « Rameau d’olivier » semble également s’inscrire dans la stratégie électoraliste du président turc. Dans un contexte de dégradation de la situation économique du pays, les élections, initialement prévues en novembre 2019, ont été avancées au 24 juin 2018. M. Erdoğan, allié aux nationalistes du MHP, espère ainsi mettre en œuvre les réformes d’hyperprésidentialisation du régime[50] avant de subir le contrecoup de la conjoncture. Une victoire de l’AKP lors du prochain scrutin entérinerait la dérive autoritaire du régime turc[51], avec Recep Tayyip Erdoğan dans le rôle de président inamovible et tout-puissant. Afin d’atteindre cet objectif, outre la mise à profit de l’état d’urgence, en vigueur depuis la tentative de putsch, pour affaiblir les partis (arrestation des leaders pro-kurdes du HDP) et les médias d’opposition, M. Erdoğan cherche à capitaliser sur l’intervention de l’armée turque en Syrie. En la promouvant sur le thème de l’expansionnisme néo-ottoman et en employant une rhétorique martiale, anti-américaine et anti-kurde[52], il espère mobiliser l’électorat nationaliste susceptible de lui assurer une victoire dans les urnes[53].
References
Par : Elise LAVILLE
Source : Centre de documentation de l'Ecole Militaire
Mots-clefs : Afrin, Erdogan, Kurdes, Offensive, Opération Rameau d'olivier, PKK, Syrie, Turquie, YPG